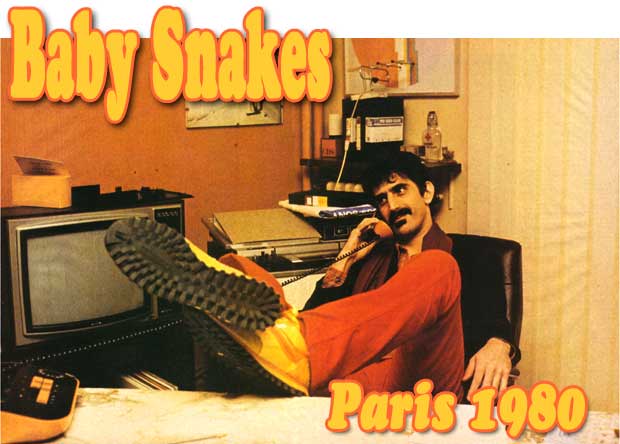
  e n’était pas en tournée ni pour
promouvoir son dernier disque que Frank Zappa était cette
fois-là à Paris, mais pour présenter son nouveau
film, « Baby Snakes ». Un film à propos de gens qui
font des choses qui ne sont pas normales. Dans sa version
intégrale de près de trois heures (qui devrait être
ramenée ici à deux heures environ, « Baby
Snakes» met en scène Zappa, bien sûr, mais aussi une
bonne partie des Mothers, de Terry Bozzio à Warren Cucurullo, du
vétéran Roy Estrada à la petite Diva Zappa. e n’était pas en tournée ni pour
promouvoir son dernier disque que Frank Zappa était cette
fois-là à Paris, mais pour présenter son nouveau
film, « Baby Snakes ». Un film à propos de gens qui
font des choses qui ne sont pas normales. Dans sa version
intégrale de près de trois heures (qui devrait être
ramenée ici à deux heures environ, « Baby
Snakes» met en scène Zappa, bien sûr, mais aussi une
bonne partie des Mothers, de Terry Bozzio à Warren Cucurullo, du
vétéran Roy Estrada à la petite Diva Zappa.
Parfait prolongement de l’oeuvre discographique du Sicilien, «
Baby Snakes» n’est pas seulement un film pour fans
inconditionnels, mais aussi une excellente introduction à
l’univers et à la folie zappaiens. Donc un film fou, fou, fou,
qui permet au responsable de l’animation des petits personnages en
pâte à modeler, Bruce Brickford, de laisser courir son
imagination débordante de perversions visuelles et autres,
jusqu’à étonner le réalisateur lui-même.
 a
deuxième heure du film est consacrée dans sa
quasi-intégralité à la retransmission d’un
concert. D’un intérêt cinématographique peu
soutenu, c’est tout de même l’occasion de voir Roy Estrada,
compagnon des premières aventures, reprendre une version
très théâtrale de « Sexually Aroused Gas Mask
». Mais la vraie vedette c’est le public, ici très
complice, qui n’hésite pas à monter sur scène pour
se livrer sous la férule du dompteur Zappa à
d’abominables sketches. a
deuxième heure du film est consacrée dans sa
quasi-intégralité à la retransmission d’un
concert. D’un intérêt cinématographique peu
soutenu, c’est tout de même l’occasion de voir Roy Estrada,
compagnon des premières aventures, reprendre une version
très théâtrale de « Sexually Aroused Gas Mask
». Mais la vraie vedette c’est le public, ici très
complice, qui n’hésite pas à monter sur scène pour
se livrer sous la férule du dompteur Zappa à
d’abominables sketches.
Neuf ans après «200 Motels s, voici donc un nouveau
monument de celluloïd qui, en dépit de son découpage
en deux parties et de quelques longueurs, deviendra vite un classique
du film musical. «Baby Snakes», ce n’est pas tout à
fait un film, ce n’est pas tout à fait un concert: c’est tout
juste du Zappa…
Après la projection, c’est un Zappa new-look, cheveux courts et
fringué comme un minet, qui répondit à nos
questions.

FRANCIS VINCENT & JEAN-MARC
BAILLEUX — Que penses-tu des gens normaux ?
FRANK ZAPPA — Les gens
normaux ont besoin des gens pas normaux. Sans les seconds, la vie
serait bien ennuyeuse. Je crois que la normalité peut être
guérie. Sans déviation, il n‘y a pas de progrès
possible, et inversement, Les gens pas normaux ont besoin de gens
normaux, Ils se complètent par contraste.
F.V. & J-M. B. — Qui
a produit le film ?
F.Z. — C’est moi. J’ai
tout payé de ma poche. J’ai eu des
contacts avec Polytel, ils ont visionné environ vingt minutes,
Ils étaient enchantés, voulaient bien le financer, mais
exigeaient en retour les droits sur mes disques pour le monde entier.
C’était tout à fait possible, je n’avais pas encore
signé pour CBS (en dehors du continent américain). Mais
ils n’offraient pas assez, et je ne voulais pas mettre en péril
ma carrière musicale pour le film. J’ai donc multiplié
les concerts pour le financer. Il m’a coûté cinq cent
mille dollars.
F.V. & J-MB. — Qui
est Bruce Brickford, qui fait les animations ?
F.Z. — C’est un des mes
fans sorti du rang. Nous nous sommes rencontrés après mon
premier film, en 1971. Il a commencé à travailler avec
moi en 73, et c’est lui qui animait «A Token 0f My
Extreme». (Le court-métrage diffusé il va quelque
temps par la télévision.)
F.V. & J-MB. — Une
musique de film bientôt?
F.Z. — Non, ce n’est pas
possible: j’ai déjà un autre album de prêt. Mais
CBS ne veut rien avant septembre, car les précédents
albums marchent bien, Nous avons eu trois albums dans les charts avec
« Sheik Yerbouti » et les deux « Joe ‘s Garage
». Sans parler de « Bobby Brown », qui est
resté en tête des hits en Scandinavie pendant plusieurs
mois. Une des raisons aussi qui font que mes disques se vendent mieux
est que CBS en assure mieux la promotion que les maisons de disques
précédentes.
F.V. & J-MB. — La
vidéo, comment la conçois-tu ?
F.Z. — Pour moi, la
vidéo est une extension de ma pratique musicale, En outre, je
m‘intéresse aussi aux nouvelles techniques, comme le
vidéo-disque par exemple. J’aimerais travailler dans ce secteur,
mais il me faudrait de l’argent pour tout ça. Tout ce que je
peux faire pour l’instant, ce sont des projets que je ne peux
réaliser moi-même, faute de moyens. Il y aura
peut-être un film sur « Joe’s Garage » si je trouve
de l’argent. Je voudrais commencer dès demain…
F.V. & J-MB. — Il y a
permanence d’un thème dans tes films, c’est la vie quotidienne
des musiciens. Tu parles de ça et, en quelque sorte, tu en fais
la démonstration par l’image...
F.Z. — Oui, c’est sans
doute que je connais un certain nombre de choses sur le sujet. Je
préfère parler de choses que je connais ou comprends. Je
ne voudrais pas faire un film sur les pilotes de course, parce que je
ne connais rien à tout ça. Et n’en ai rien à faire
non plus. De la même façon, je ne pourrais pas en faire un
sur les footballeurs... Je ne connais que les musiciens.
F.V. & J-MB. —
Revenons à tes dernier disques. Avec des chansons comme
«Bobby Brown» et «Don’t Work For Yuda », tu
sembles retourner à tes amours pour la musique noire et le
rhythm and blues...
F.Z. — J’aime ça,
tous ces trucs... Mais il est difficile de trouver des chanteurs pour
ce genre de musique. En fait, c’est devenu presque impossible depuis
que ce style est passé de mode, et on ne peut trouver des gens
qui veulent chanter comme ça. Il me faut donc chercher un peu
partout des gens capables de le faire.
F.V. & J-MB. — Tu
avais Roy Estrada et Ray Collins...
F.Z. — Oui, mais Roy est
maintenant dans un asile. S’il a de la chance, il sortira en avril et
je le prendrai pour enregistrer. Mais II y est resté presque
deux ans, aussi... Quant à Ray Colins, il est chauffeur de taxi
et sa voix est dans un très mauvais état. Il a eu des
problèmes de drogue.
F.V. & J-MB. —
Jouais-tu dans des groupes du style «Ruben And The Jets »
quand tu étais au lycée ?
F.Z. — Pas exactement
comme « Ruben And The Jets»: les groupes dans lesquels je
jouais sonnaient presque bien. (Sourire sardonique.)
F.V. & J-MB. — Tu as
quitté la batterie pour la guitare à dix-huit ans.
Pourquoi ?
F.Z. — Jouer de la
guitare représentait pour moi la possibilité de composer
instantanément, mais j’ai en fait commencé à jouer
de la guitare parce que j’aimais le blues.
F.V. & J-MB. — C’est
important pour toi, le blues ?
F.Z. — J’ai toute une
collection de disques de blues. Une grande collection, même, de
cette musique que j’aime vraiment beaucoup. J’en apporte toujours avec
moi en tournée, pour écouter sur la route ou à
l’hôtel.
F.V. & J-MB. —
Parle-nous du lycée de San Diego. Comment percevais-tu le rhythm
and blues, le jazz?
F.Z. — Je
détestais le jazz. Je pensais par contre que le rhythm and blues
était merveilleux. Dans mon lycée, il y avait une grande
séparation entre les gens qui aimaient le jazz et ceux qui
adoraient le rhythm and blues. Il y avait des bagarres. Parce que ceux
qui aimaient le jazz disaient aux autres: la musique que vous aimez,
c’est de la merde !
F.V. & J.-M.B. — Quel
genre de jazz était-ce ?
F.Z. — A cette
époque, c’était Howard Rumsey and his Lighthouse All
Stars. Et des trucs du genre « Martians Go Home » de Shorty
Rodgers. (Rires.) Comment pouvions-nous aimer ça?
F.V. & J-MB. — Oui,
mais quand tu montres ton intérêt pour Eric Dolphy, tu ne
peux pas dire que tu détestes complètement le jazz.
F.Z. — J’aime Eric Dolphy
non parce qu’il fait du jazz, mais parce que j’aime ce qu’il fait. Il
pourrait faire du country and western que je m‘en moquerais, puisque
j’aime ça. Tu sais, j’essaie d’apprécier les choses pour
ce qu’elles sont... Je n’aime pas les tendances ou les mouvements et
toutes les choses de ce genre, parce qu’il y a toujours un truc
intéressant, pris individuellement, mais jamais tout. C’est
comme en pop-music, quand les punks sont arrivés: il y a une ou
deux chansons que j’aime bien, mais le reste, je n’en ai vraiment rien
à faire.
F.V. & J-MB. — C’est
surtout une étiquette ?
F.Z. — C’est plus une
excuse pour s’habiller de façon surprenante qu’un réel
mouvement musical.
F.V. & J-MB. — Quand
on parle de tes influences jazzy, on cite souvent Ayler, Coltrane,
Mingus. On dit que tu aimes beaucoup Mingus...
F.Z. — C’est tout
à fait vrai mais j’aime aussi Thelonious Monk, les premiers
enregistrements de Wes Montgomery, avant qu’il ne mette des cordes
partout... Il n’y en a pas tellement, finalement. J’aime certains
disques de Coltrane, j’ai un Albert Ayler. Deux disques d’Archie Shepp,
aussi. En fait, je n’écoute pas tellement de jazz, et surtout
pas ce qui se fait en ce moment, parce que ce n’est rien d’autre que du
disco. Ils veulent faire du disco compliqué. Si je veux
écouter du disco, je préfère écouter Diana
Ross et Donna Summer.

F.V. & J-MB. — Les
quatre derniers disques publiés par Warner (« In New
York », « Studio Tan », « Sleep Dirt » et
«Orchestral Favorites ») étaient-ils
constitués des enregistrements destinés à sortir
en coffret ?
FZ. — Oui.
F.V. & J.-M.B. — Tout
ce que devait contenir le coffret a été publié ?
FZ. — Oui. J’ai beaucoup
d’autres bandes de ces séances, mais tout ce que j’avais
sélectionné pour le coffret est dans les quatre disques.
FV. & J-MB. —
Pourquoi le projet n’a-t-il jamais vu le jour dans sa forme originelle ?
F.Z. — Warner n’a fait
aucune promotion, Les disques sont sortis sous les plus affreuses
pochettes que j’aie vues de ma vie, sans aucune information, parce que
Warner n’avait légalement pas l’autorisation de les publier.
Warner n’avait pas de licence, aucune information d’édition,
aucun crédit pour les musiciens; personne ne savait qui jouait
sur quoi. En fait, cela s’est passé ainsi: j’avais encore un an
et demi de contrat avec Warner, je leur devais quatre albums. Mon
contrat stipulait que lorsque je leur remettais une bande, ils devaient
me remettre un chèque. Je suis arrivé un matin avec mes
quatre albums et j’ai réclamé mon argent et ma
liberté. Ils ont pris les bandes, les ont publiées et ne
m’ont jamais payé. Ni chèque, ni royautés. C’est
une grosse perte qui m’a beaucoup gêné pour travailler.
F.V. & J.-M.B. — Tu
es en procès avec Warner ?
F.Z. — Oui, c’est en
cours.
F.V. & J.-M.B. —
Peux-tu nous donner quelques informations sur ce qui aurait dû
être le projet initial ? Le découpage en quatre albums, la
sélection des titres pour chacun, l’ordre des morceaux te
satisfait-il?
F.Z. — D‘abord, je livre
toujours à la maison de disques un produit fini. Je veille
personnellement à la réalisation des pochettes, ce que je
n‘ai pu faire que pour le premier Sorti, le « Live In New York
»; ensuite je suis tout le processus jusqu’à la gravure,
je fais moi- même les ultimes corrections et
l’équalisation finale, de façon à obtenir
exactement le son que je désire. Pour aucun de ces disques je
n’ai pu faire ce travail. On ne m’a même pas prévenu de la
gravure. Le son est gâché, alors que la musique est bonne.
Ça me rend fou de voir de la musique mal gravée et
emballée dans des pochettes horribles.
F.V. & J-MB. —
Envisages-tu de republier un jour l’ensemble proprement ?
F.Z. — Quand l’affaire
sera jugée, j’espère récupérer mes bandes
et sortir le coffret prévu initialement. En fait, ça a
été une monumentale erreur de la part de Warner de
refuser de sortir le coffret. A l’époque où je leur ai
livré les bandes, ce n’était pas encore la « crise
du disque ». Il y avait un grand coup de marketing à
faire, le coffret aurait fait beaucoup de bruit, beaucoup plus de bruit
avec une telle quantité de musique publiée d’un seul coup
et promue comme un événement sans précèdent
qu’avec des disques séparés et sortis le plus banalement
du monde. C’eût été plus intelligent de leur part.
Ils auraient certainement vendu plus de coffrets que d’aucun des
disques séparés. Mais ils avaient à
l’époque des problèmes beaucoup plus importants que moi,
comme sortir un nouveau Fleetwood Mac. Tu sais, quand on a ce genre de
projet en cours, il est difficile d’accorder la moindre attention au
reste. Je ne vends pas dix-sept millions d’albums, donc je ne vaux pas
la peine qu’on s’attarde, qu’on s’occupe de ce que j’enregistre, qu’on
me laisse un an et demi en studio et qu’on me laisse dépenser un
million deux cent mille dollars pour un seul album. Quand on a sur son
label un artiste qui monopolise de tels moyens et réclame ce
genre de chiffres, il faut veiller au grain. En comparaison, ce que je
fais n’a pas de sens pour eux en termes de business; ils se disent
juste: « OK, sortons ces petites merdes et voyons ce qui se
passe. »
F.V. & J-MB — Avec le coffret, avais-tu
l’intention de réaliser une sorte de panorama musical, une somme
de tout ce que tu es capable de créer en musique ?
FZ. — Oui. Imagine un peu
dans la même boîte « The Black Page », «
Redunzl », « Filthy Habits », « Sleep Dirt
» des morceaux live, d’autres avec grand orchestre. Si tu aimes
la variété dans une certaine qualité, c‘est assez
excitant. Ça l’est beaucoup plus si tu maintiens les contrastes
d’une plage à l’autre, comme dans le « Live In New York
» que si tu découpes le tout en tranches et en
catégories. Mon idée était que quelqu’un de
musicalement ouvert pourrait entendre s’entrechoquer et se superposer
des genres diamétralement opposés dans un ensemble
où aucun d’eux ne serait plus particulièrement mis en
valeur. C’était ça, le projet du coffret.
F.V. & J-MB. — Quel
était l’orchestre que tu as utilisé pour les morceaux en
grande formation de «Studio Tan» et «Orchestral
Favorites » ?
F.Z. — C’était un
orchestre essentiellement constitué de musiciens de studio de
Los Angeles.
F.V. & J-MB. — Des
musiciens classiques ?
F.Z. — Tu sais, les
musiciens de studio de LÀ. sont capables de jouer n’importe
quoi, des jingles pour Pepsi Cola aux symphonies de Mozart. Ce sont
juste des « musiciens à louer ».
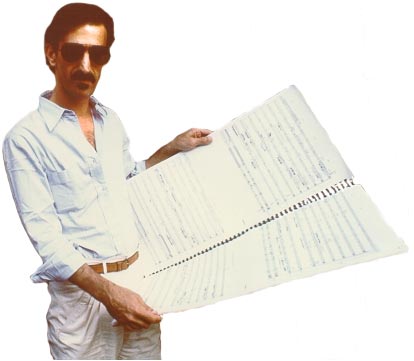 F.V. &
J-MB. —
Combien étaient-ils ? F.V. &
J-MB. —
Combien étaient-ils ?
F.Z. — Quarante, y
compris Terry Bozzio à la batterie.
F.V. & J-M-B. —
Envisages-tu de tourner avec un grand orchestre ?
F.Z. — Pourquoi crois-tu
que j’ai apporté ces partitions ? C’est parce que j’essaie de
les faire jouer.
F.V. & J-MB. — Je
veux dire: vas-tu essayer de tourner avec la musique d’«
Orchestral Favorites », par exemple ?
F.Z. — Cela revient au
même. En fait, c’est impossible de « tourner » avec
un grand orchestre. D‘abord parce que cela coûte trop cher;
ensuite parce qu’il est extrêmement difficile de trouver un son
correct en dehors du studio. Ajoute à cela que les salles
européennes sont répugnantes.
F.V. & J-MB. —
Pourquoi alors un musicien estimable comme toi accepte-t-il d’y jouer ?
F.Z. — Je n’ai pas le
choix. Peut-être y a-t-il de bonnes salles, mais elles sont ou
trop petites, ou fermées au rock. Montre-moi une bonne salle qui
contienne dix mille personnes, et j’y joue demain. La France est le
pays du monde où les salles de concert de rock sont les plus
dégueulasses. Tu dois comprendre que pour un musicien c’est un
acte de dévouement que de venir jouer en France.
F.V. & J-MB. — Mais
prends Leonard Bernstein, qui peut lui aussi attirer dix mille
personnes. Il est venu récemment à Paris et il a
joué plusieurs jours dans des salles de deux mille places...
F.Z. — D’accord,
examinons le cas de Leonard Bernstein. Combien de roadies a-t-il ?
Aucun ! Combien de musiciens dans son groupe ? Zéro ! Il dirige
l’orchestre local. On lui paie son cachet, son billet d’avion, sa
chambre d’hôtel, c’est tout. Quand je voyage, j’ai vingt- six
personnes sur la route, vingt-six salaires, vingt-six bouches à
nourrir, sans parler de l’équipement. Les coûts que cela
implique m’interdisent complètement de jouer dans des salles de
deux mille places.

F.V. & J-MB. —
Pourquoi changes-tu si souvent de musiciens ?
F.Z. — Parfois j’en
change, parfois ils décident de faire autre chose. Ils gardent
leur place aussi longtemps qu’ils le désirent, aussi longtemps
qu’ils aiment ce qu’ils font.
F.V. & J-MB —Tes relations avec Terry Bozzio
semblaient musicalement excellentes, pourquoi a-t-il quitté le
groupe ?
F.Z. — Il est parti. Il a
fait partie du groupe pendant trois ans, puis il a décidé
qu’il voulait être une Rock’n’Roll Star en lettres capitales, Il
a rejoint UK pendant un an et demi. Quand Eddie Jobson et Terry Bozzio
étaient tous les deux dans mon groupe, ils étaient les
meilleurs amis du monde. Dans UK Eddie était le patron, et en
plus il y avait deux Anglais et un Américain qui lui servaient
d’esclaves. Terry ne l’a pas supporté. Il est parti.
F.V. & J-MB. — Mais
n’y a-t-il pas quelque part une volonté résolue de ta
part de changer de temps en temps d’équipe ?
F.Z. — Mets-toi à
ma place: à chaque fois que je change un musicien, il faut que
je forme le nouveau venu. Cela prend beaucoup de temps et coûte
beaucoup d’argent. Ce serait plus facile et plus rentable pour moi de
garder toujours le même groupe. Seulement, je ne peux pas garder
quelqu’un qui n’est pas complètement dévoué
à son travail. S’il a l’esprit ailleurs, je n‘en veux plus: il y
a trop d’excellents musiciens qui rêvent de prendre sa place. Je
reçois des cassettes, des partitions, des lettres de musiciens
du monde entier, et ce parce que j’ai le seul groupe important reconnu
partout et existant depuis Iongtemps que n’importe qui peut rejoindre
s’il en a la capacité. J’auditionne tous ceux qui se
présentent, et je suis le seul à offrir une telle
opportunité. Il n’y a aucun moyen d’entrer dans Led Zeppelin.
Les musiciens le savent. C’est une bonne chose qu’ils sachent aussi que
ma porte n’est jamais close, il y a des gens qui m’ont sollicité
plusieurs fois sans succès, jusqu’à ce que leur moment
vienne. Prends Craig Steward, par exemple: il est venu auditionner
à l’époque de « Roxy & Elsewhere ». Il
était déjà excellent, mais il ne pouvait pas
apprendre ses parties assez vite, pas aussi vite que George Duke et les
autres, il nous ralentissait. Je lui ai dit: « Rentre chez toi,
travaille et rappelle-moi dès que tu te sens prêt, »
C’est ce qu’il a fait, et maintenant il est dans le groupe.
F.V. & J.-M.B. —
Autrefois, tu citais quelques musiciens avec lesquels tu souhaitais
travailler. Y a-t-il des musiciens que tu inviterais à rejoindre
le groupe ?
F.Z. — Personne de connu.
J’aurai toujours du plaisir à jouer avec Aynsley Dunbar... et
George Duke, aussi.
F.V. & J-MB. —
Comment expliques-tu que bien des musiciens n’ont jamais
été meilleurs que lorsqu’ils travaillaient avec toi ?
F.Z. — Rien ne remplace
la DISCIPLINE, et c’est la première chose que n’importe quel
musicien doit apprendre en entrant dans le groupe: la discipline. Je ne
parle pas de punitions, seulement du respect du travail collectif. Tu
dois connaître pas mal de musiciens. As-tu remarqué que ce
sont les gens les plus fainéants du monde ? Ils ne font jamais
ce qu’on leur demande à temps, parce qu’ils sont
fainéants comme des couleuvres. Ils croient que l’univers va les
combler de ses bienfaits parce qu’ils sont si super. Et ils se
trompent. Car si on veut faire un disque ou une tournée, il faut
commencer par beaucoup travailler, répéter, repousser ses
limites. Si on n‘est pas capable de faire cela tout seul, il faut que
quelqu’un vous y contraigne. C’est tout ce que je fais. Je demande aux
musiciens de faire des trucs qu’ils n’ont jamais eu l’occasion de faire
auparavant; et s’ils veulent continuer avec le groupe, il faut qu’ils
réussissent. C’est comme ça que ça marche.
Après cela, lorsqu’ils partent ils se disent: « Enfin
libre, plus de discipline, je vais enfin être super de nouveau.
» Et ce qui se passe, c’est qu’ils sont super et qu’ils ne font
rien. Parce qu’il n’y a plus personne pour les inciter à
s’épanouir. La plupart d’entre eux arrêtent de progresser
en quittant le groupe.
F.V. & J-MB. —
Revenons à Mingus. On te trouve en général au
moins un point commun avec lui: la même façon de
travailler avec les musiciens, la même rigueur dans le travail
orchestral...
F.Z. — Je ne suis pas un
expert de Charlie Mingus, je ne connais pas ses habitudes, mais il y a
une ou deux choses que j’ai entendu dire; notamment que la discipline
l’amenait à boxer ses musiciens pour les foutre dehors. (Rires.)
Je n’ai jamais touché un de mes musiciens pour m’en
séparer. (Rires.)
F.V. & J-MB. — Tu
aimes les responsabilités ?
F.Z. — Bien sûr. Je
suis mon seul employeur.
F.V. & J-MB. — Mais
est-ce par choix ou par obligation ?
F.Z. — Quand quelqu’un te
finance, à moins d’être dans un domaine
spécialement organisé de façon à
éviter que cette personne n‘intervienne dans la
réalisation des projets, tu te trouves toujours dans une
situation paradoxale où le sponsor a un droit de regard sur ce
que tu fais. Donc, pour moi, il est préférable que je me
finance moi-même pour que personne n’ait à me dire ce que
j’ai à faire. Je prends l’entière responsabilité
financière et artistique de tout ce que j’entreprends. C’est
mieux ainsi.
F.V. & J-MB. —
Même si cela te prend cinq ou dix ans de plus ?
F.Z. — J’ai eu ce genre
de dilemme. Mais je pense que les gens qui sont
intéressés par ce que je fais préféreront
toujours connaître ce que moi j’ai voulu faire plutôt que
ce que mon producteur m’a fait faire.
F.V. & J-MB. — As-tu
toujours agi ainsi ? Est-ce que tous les disques que tu as
réalisés l’ont été à l’abri de toute
ingérence extérieure ?
F.Z. — Pas les trois
premiers, que Verve a pas mal censurés. Ensuite, j’ai fait ce
que je voulais.
F.V. & J-MB. —
N’as-tu jamais réalisé certains disques, comme
«Chunga’s Revenge» par exemple, en vue de financer d’autres
projets (« 200 Motels») ?
F.Z. — Non, dans ce sens
qu’il est impossible de considérer aucun de mes disques comme
capable de financer quoi que ce soit, (Rire.) Surtout publiés et
promus par Warner Bros. En plus, la plupart de mes disques ont toujours
eu des destins commerciaux très inégaux, même d’un
pays à un autre. Certains sont de gros succès dans un
pays et des flops complets ailleurs. « Chunga’s Revenge » a
marché très fort en Italie et en Thaîlande, «
Waka Jawaka » et « Grand Wazoo» ont fait de gros
scores en Finlande, « Fillmore East » et «Just
Another Band From LA. » ont été disques d’or en
Australie.»

F.V. & J-MB. — A
propos de «Uncle Meat », tu as parlé quelque part de
l’influence de Colon Nancarrow...
F.Z. —
(étonné) Vous ne le connaissez pas ? C’est un compositeur
qui vit à Mexico, mais il est né dans le Kentucky. Il
écrit des musiques pour piano qu’il est humainement impossible
de jouer. Aussi fait-on appel à une machine, tellement c’est
compliqué. Il y e beaucoup de canons bizarres et de structures
étranges.
F.V. & J-MB. — J’ai
lu que tu aimais « la nourriture avec beaucoup de cayenne et la
musique avec beaucoup de dissonnances». C’est une bonne
définition de ta musique, mais pourrais-tu nous donner des
détails sur ta méthode de travail. Dans la pratique,
comment composes-tu ?
F.Z. — La plupart du
temps en tournée. J’ai toujours mon cartable, avec du papier
à musique. J’ai une heure à attendre dans un
aéroport, je sors mon papier, je le pose sur mon cartable et
j’écris. J’écris à l’hôtel, dans l’avion,
dans les coulisses... Quand je reviens de tournée, je mets tout
cela en ordre: je joue certaines sections au piano, je fais des
corrections, je structure des morceaux et je les orchestre.
F.V. & J-MB. — Quelle
formation as-tu eue ?
F.Z. — J’ai
fréquenté les bibliothèques et
écouté des disques.
F.V. & J-MB. — Cela
parait tout simple !
 F.Z. —
C’est tout simple.
Si tu ne prends pas les choses ainsi, tu vas au conservatoire. On te
dit « lis ce livre ». Ce n’est pas nécessaire de se
payer des études si c’est pour en arriver là, Autant
aller directement au fait. Vous voulez voir des partitions ? F.Z. —
C’est tout simple.
Si tu ne prends pas les choses ainsi, tu vas au conservatoire. On te
dit « lis ce livre ». Ce n’est pas nécessaire de se
payer des études si c’est pour en arriver là, Autant
aller directement au fait. Vous voulez voir des partitions ?
F.V. & J-MB. — Et
comment ! (Moment émouvant où le Maître mande son
garde du corps quérir deux monumentaux cahiers reliés
format mammouth et contenant l’orchestration intégrale pour
guitare, percussions et orchestre de cent huit musiciens de quatre
grands oeuvres « Bon In Dacron », «Sade Jane »,
« Mo’n Herb’s Vacation» et « Voööol
», morceaux de bravoure au destin confus. « Sad Jane»
devait être interprété par l’Orchestre
Philharmonique de Vienne sous la direction de Frank, mais le projet dut
être abandonné faute de subsides (encore), la TV
autrichienne refusant de payer les droits réclamés pour
l’enregistrement de l’événement, Frank a depuis
confié l’ensemble au responsable du catalogue classique CBS pour
qu’il le fasse parvenir à Pierre Boulez. Mais il paraît
aujourd’hui plus probable que les oeuvres soient montées par le
London Symphony Orchestra. Affaire à suivre...)
F.V. & J-MB. —
Lorsque tu envoies des partitions à l’IRCAM, n’est-ce pas que tu
cherches à te faire accepter de l’intelligentsia
culturalo-contemporaine ?
 F.Z. —
Non. Si j’envoie
des partitions à Boulez, c’est qu’il est plus qualifié
que moi pour les diriger. Ce n’est pas pour avoir sa
bénédiction ou une bonne note comme pour un exercice
scolaire, mais parce que ce sont des partitions difficiles et qu’il est
un excellent technicien de la direction d’orchestre. F.Z. —
Non. Si j’envoie
des partitions à Boulez, c’est qu’il est plus qualifié
que moi pour les diriger. Ce n’est pas pour avoir sa
bénédiction ou une bonne note comme pour un exercice
scolaire, mais parce que ce sont des partitions difficiles et qu’il est
un excellent technicien de la direction d’orchestre.
F.V. & J-MB. —
Etait-ce pour la même raison que tu avais envoyé
«200 Motels» à Zubin Mehta ?
FZ. — Oui. A moins de
consacrer le reste de mes jours à apprendre à diriger un
orchestre classique, il vaut mieux que je loue les services de
quelqu’un qui a les aptitudes mécaniques et la formation pour le
faire à ma place.
F.V. & J-MB. — Que
penses-tu du pirate qui a été enregistré à
l’occasion du concert de «200 Motels» avec le LA.
Philharmonique dirigé par Zubin Mehta.
F.Z. — Je ne l’ai jamais
entendu.
F.V. & J-MB. — Tu as
souvent fait des références explicites à la
musique contemporaine sur tes pochettes. Tu es un grand admirateur de
Varese, entre autres. Te soucies-tu d’obtenir quelque sorte de
reconnaissance de ce « milieu culturel»?
F.Z. — Pas du tout. Car
le public pour cette musique — si elle a un public — n’a aucun lien
avec la plus grande part de ce que je produis.
F.V. & J-MB. — Mais
ne crois-tu pas que beaucoup de ceux qui achètent tes disques
sont aussi ceux qui achètent Varese ou d’autres contemporains ?
F.Z. — S’ils le font,
c’est souvent parce que c’est moi qui ai attiré leur attention
sur ces musiciens, non pas par simple curiosité. Malgré
tout, je crois qu’il y a aujourd’hui un marché beaucoup plus
large parmi les jeunes pour la musique contemporaine que jamais
auparavant. Il y a de plus en plus de gens qui recherchent autre chose
qu’Eagles ou Linda Ronstadt, un son nouveau, une plus grande
liberté. Cependant, le public habituel de la musique
contemporaine reste beaucoup trop constitué d’intellectuels qui
discutent mathématique et non musique après chaque
concert. Ceux-là, il ne m’intéresse pas
spécialement de les atteindre.
F.V. & J-MB. —
Pourtant, tu es le seul à le faire dans le domaine de la musique
dite « populaire ». Beaucoup de tes fans sont des «
intellectuels du rock».
F.Z. — Peut-être en
France. Mais c’est très différent d’un pays à
l’autre. Et puis je parlais de ce type d’intellectualisme qui
mène à un cul-de-sac. Quand on prend une idée
musicale et qu’on la sophistique au point qu’elle n’existe plus
musicalement, comment peut-on y trouver le moindre plaisir ? Cela
devient un jeu purement abstrait et vide de sens.
F.V. & J-MB. —
Cependant, certaines sections de « Gregory Pecary » sont
aussi complexes et sophistiquées que bien des morceaux de
musique intellectuelle.
F.Z. — Et alors ?
L’important, c’est que cela n’empêche pas les kids d’aimer
« Gregory Pecary ».
F.V. & J-MB. —
Evidemment, mais alors pourquoi Varese, que tu aimes, ou Penderecki
ont-il tant de mal à se faire apprécier par le plus grand
nombre ? N’est-ce pas simplement parce qu’ils ont une fausse image ?
F.Z. — Je ne sais pas.
Personnellement, l’« image » me concerne peu. Quand
j’écoute de la musique, je ne me préoccupe pas
d’où elle vient mais seulement de savoir si elle est bonne ou
pas, si elle me plaît ou non.
F.V. & J-MB. —
Qu’écoutes-tu plus particulièrement dans ce domaine ?
F.Z. — Je possède
à peu près tout Penderecki mais je n‘aime pas tout
inconditionnellement. J’aime surtout sa musique pour orchestre, bien
que mon oeuvre préférée soit son opéra
« Les Diables de Loudun ». J’aime aussi le concerto pour
violoncelle. J’ai tout ce qui a été enregistré de
Varese, et j’aime tout sans exception. J’ai une grande collection de
Stravinski 90 % de ce qu’il a composé. Ce que j’aime par dessus
tout, c’est « L’histoire du Soldat » (E.F.D.T.), plus
particulièrement « La Marche Royale » (l’indicatif
de l’émission « Six Huit » sur France Musique le
soir): c’est exactement ce que je cherche en musique. J’aime
naturellement les grands ballets, « Le Sacre du Printemps
», « Petrouchka », « L ‘Oiseau de Feu »
et «Agon ». Je n’aime pas trop la période
néo-classique, ni ses dernières oeuvres sérielles
(à part «Agon »). J’aime Takemitzu...
F.V. & J-MB. — Te
considères-tu comme un musicien de rock ?
F.Z. - Je suis
COMPOSITEUR. Un compositeur qui ne compose pas qu’avec des notes. Quand
je forme un groupe, je crée une sculpture vivante de
personnalités qui, entre autres choses, jouent des notes de
musique. Tout ce que je fais, je le fais en termes de composition.
Composer, c’est organiser les événements suivant
certaines structures. On peut le faire avec des notes de musique, avec
des idées, des objets. Tu prends ce plateau, tu mets la tasse et
la cuillère ici, c’est country & western; tu les mets
là, c’est soft rock. Tu as saisi ?
F.V. & J-MB. —
Qu’arrive-t-il après l’interdiction complète de la
musique ? Y a-t-il un Acte IV à « Joe’s Garage» ?
F.Z. — Il n’y a pas
d’Acte IV. Je pourrai changer d’avis, mais pour l’instant il n’y a pas
d’Acte IV.
F.V. & J-MB. — Alors
quoi d’autre ?
F.Z. — J’ai
déjà terminé un disque en public. Mais je ne sais
pas si ce sera le prochain à sortir, car la prochaine sortie est
prévue pour septembre et d’ici là j’ai le temps
d’enregistrer des tas de choses.

F.V. & J-MB. — Qu’est
devenu le musico des Sixties qui n’avait aucun potentiel commercial ?
F.Z. — Tu sais,
commercialement je ne vaux toujours pas grand-chose si tu mets la barre
à dix-sept millions d’albums.
F.V. & J-MB. —
Combien pèses-tu ?
F.Z. — Environ six cent
mille dans le monde.
F.V. & J-MB. —
Pourquoi as-tu coupé tes cheveux ?
F.Z. — Parce que
j’étais fatigué de répondre aux questions sur les
Années 60 et que j’en avais dans la bouche quand je mangeais.
(Propos
recueillis par FRANCIS VINCENT et JEAN-MARC BAI LLEUX.)
Parution
: Rock & Folk, n°161 de juin 1980.
|

