 Q Quand
on arrive à
l’aéroport de Los Angeles, après une nuit blanche et de
trop nombreux Martini pour tuer l’ennui de quinze heures d’avion, on
est déphasé. La ville est à la dimension de ses
fantasmes dix millions d’individus se partagent les « blocks
» d’une mini planète qui s’étale sur cent
kilomètres de bitume : une Cadillac passe sans s’arrêter
devant un auto-stoppeur au visage ravagé par de trop nombreux
produits chimiques.
C’est sous une pluie fine que le taxi remonte Sunset Boulevard
où un Eric Clapton de quinze mètres de large sur dix
mètres de haut bouge des bras mécaniques sur sa guitare.
« Man, this city really boogie ». Me dit
le chauffeur de taxi. On est bien Hollywood, le tronc terrestre du show
business, la mère féconde de centaines de stars, la ville
des espoirs, de la folie, des désillusions, où le terrien
moyen se sent mal et où l’extra-terrestre moyen se sent bien.
Lundi. C’est le lendemain de Noël ; tout est fermé et il
pleut, j’ai le choix entre écouter l’une des douze stations FM
de rock et regarder la télé ; je préfère
dormir et garder mon énergie pour le soir car les RUNAWAYS
jouent dans une boite à dix mètres de mon hôtel, et
ces quatre petites nanas de dix-huit ans savent vraiment vous sucer
tous vos neurones. Mais le but de mon voyage était bien d’aller
dénicher M. ZAPPA dans son antre.
ZAPPA qui observe
l’Amérique du haut de ses trente-sept ans,
dix-huit ans de musique, deux mille interviews, le créateur
polyvalent, la machine à génie. On a dit beaucoup de
choses sur ZAPPA, qu’il était tyrannique avec ses musiciens,
qu’il ne supporte pas les journalistes, qu’il se tourne vers une
musique plus « commerciale »... BEST est allé chez
lui, à Laurel Canyon, faire la part de vrai et de faux, Une
Rolls-Royce noire garée devant une grande maison rose et jaune,
au beau milieu des silencieuses collines de Laurel Canyon, c’est la que
ZAPPA a vécu dix ans de son histoire. Seule une petite lampe
éclaire son visage très sérieux dans cette grande
pièce sans fenêtre où des machines bizarres
attendent les informations du maître pour convertir
l’idée, en produit fini. Il a l’air nerveux et ennuyé,
ses longs cheveux pendent sur sa chemise ouverte.
Gilles Riberolles : Pourquoi
t’es-tu sépare d’Herb Cohen avec qui tu as fondé ton
label BIZARRE ?
Frank Zappa : Parce que je l’accuse de fraude et de diverses
activités malintentionnées.
G. R : Es-tu satisfait de la
compagnie WARNER BROS!
F. Z. : Non, ce sont des personnages répugnants.
G. R. : Vas-tu à nouveau
créer ton propre label ?
F. Z. : J’essaierai, mais la WARNER a rendu impossible la signature de
deux contrats l’année dernière, un avec EMI et l’autre
avec PHONOGRAM. Ils se sont opposés à la signature de ces
contrats. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai été
trompé par deux sortes de gens : la première est le
manager en qui j’avais confiance depuis onze ans, et l’autre est cette
énorme firme appelée WARNER BROS qui ne m’a pas
payé mes droits depuis un an, et qui a essayé
d’influencer le reste de mon travail en m’écartant
d’éventuels travaux avec d’autres compagnies ; et ça va
aller jusqu’en justice. Ça prend de trois à cinq ans aux
U.S.A. pour exposer ce genre de cas à un tribunal mais je
suppose que ce sera quand même étalé sous les yeux
d’un juge.
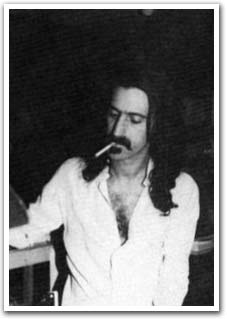 G. R. : Est-ce que
ça signifie que nous n’aurons pas de disque avant quatre ou cinq
ans ? G. R. : Est-ce que
ça signifie que nous n’aurons pas de disque avant quatre ou cinq
ans ?
F. Z. : C’est une question compliquée parce que la WARNER essaie
de faire sortir des disques qu’ils n’ont pas le droit de faire sortir
mais j’essaie de les en empêcher par des moyens légaux;
sinon il est possible que je ne sorte pas de disque avant quatre ou
cinq ans.
G.R. : Est-ce une
procédure typique de la W. B. ?
F. Z. : Je ne sais pas si c’est typique, mais c’est ce qui s’est
passé ; j’avais un contrat spécifiant que je devais leur
remettre quatre albums le 31 décembre 77, et je l’ai fait en
mars 77 ; je suis allé a leur bureau, et je leur ai donné
les quatre bandes complètes; ils étaient sensés me
payer lors de la remise des bandes, mais ils ne l’ont pas fait.
Ils n’ont pas rempli le contrat à deux niveaux différents.
G. R. : A combien
s’évaluait le contrat ?
F. Z. : Ils devaient me donner 60 000 dollars par album. Ils me doivent
donc 240 000 dollars «1 200 000 NF).
II
allume sa deuxième cigarette.
G. R. : Tu as fait plusieurs
films, mais certains tel que « UNCLE MEAT » ne sont pas
sortis. Pourquoi ?
F. Z. : Pour le cas de « UNCLE MEAT » je n’avais pas assez
d’argent pour le finir.
G. R. : Personne n’a voulu le
produire ?
F. Z. : C’est moi qui investissais l’argent mais je suis devenu
fauché. Et le film TV que vous avez vu en France n’est jamais
passé aux U.S.A.
G. R. : Tu n’as pas eu le
même succès en tant que cinéaste qu’en tant que
musicien, sont-ils conçus dans un esprit différent ?
F. Z. : Non ce n’est pas la même chose, les disques
étaient le produit de différents groupes, et ce sont deux
audiences différentes; il y a bien sûr une couche commune,
mais l’audience de mes disques n’est pas grande non plus de toute
manière, alors si je devais compter sur les gens qui
achètent mes disques pour aller voir mes films…
G. R. : Quelle a
été ta formation préférée des
« MOTHERS OF INVENTION » parmi les 13 ou 14 avec lesquelles
tu as joué ?
F. Z. : J’aime celle que j’ai maintenant.
G. R. : La même que dans
« ZOOT ALLURES » ?
F. Z. : Non, Il y a deux musiciens qui étaient en France
l’année dernière, le bassiste et le batteur (Pat O’ Hearn
et Terry Bozzio). Il y a deux personnes aux daviers : Tommy Mars et
Peter Wolf qui est de Vienne ; Roy Estrada est revenu avec nous, il
chante, Adrien Belew est l’autre guitariste, il vient de Nashville, et
nous avons un nouveau percussionniste appelé Ed Man.
G. R : C’est le groupe avec
lequel tu vas partir en tournée le 11 janvier ?
F. Z. : Oui. Nous resterons probablement six semaines en Europe; nous
donnerons trois concerts à Paris, un à Colmar et un
à Lyon pour la France.
G. R. : Es-tu toujours
intéressé par ce qui se passe sur la scène
européenne ?
F. Z. Juste ce que je peux en lire dans les journaux et je suis
sûr que ça ne donne pas d’indications précises de
ce qui s’y passe réellement.
G. R. : Qu’est-ce que tu penses
du mouvement punk comme critique sociale ?
F. Z. : Je pense qu’il se parodie lui-même. C’est juste un nouvel
exemple des extrêmes auxquels en arrivent les maisons de disques
pour vendre leurs produits. Les gens sont si conditionnés que si
on leur dit qu’il y a quelque chose de nouveau il faut qu’ils
l’achètent; j’ai entendu quelques groupes punk qui faisaient
quelque chose de musical et que j’ai aimé tels que BLONDIE par
exemple, mais le mouvement punk dans son ensemble n’est pas une
critique sociale, c’est du mercantilisme.
G. R. : Donc les musiciens
n’auraient rien à exprimer ?
F. Z. : Je pense qu’au début beaucoup de gens impliqués
dans le mouvement punk n’étaient pas du tout des musiciens ;
c’était juste des gens qui avaient une certaine allure, qui
furent rassemblés par des promoteurs qui leurs disaient :
« Tu fais ci, tu fais ça » et on va en faire un
disque. Les SEX PISTOLS en sont un exemple typique.
G. R. : Es-tu toujours un freak ?
F. Z. : Bien sûr.
G. R. : Ta musique est-elle
toujours influencée par une critique de l’Amérique ?
F. Z. : Oui j’ai mon idée sur l’Amérique.
G. R. : Te sens-tu un musicien
américain ?
F. Z. : Absolument, je suis 100 % américain, mais pas de la
façon dont les Européens l’imaginent.
G. R. : La plupart des musiciens
de rock aux U.S.A. ne sont pas « Intellectuels » dans leur
musique...
F. Z. : C’est leur problème.
G. R. : Oui mais toi tu l’es ;
tu es différent des autres rock stars dans la mes…
F. Z. : La différence principale est que je ne suis pas une rock
star, je suis une légende. Si j’avais été une rock
star, tu ne serais pas ici.
G. R. : Pourquoi?
F. Z. : Parce que les rock stars ont une vie et une esthétique
différentes; c’est-à-dire basées sur le fait de
s’amuser tout le temps, pendant que quelqu’un d’autre fait le travail
pour eux.
G. R. : Es-tu aussi
discipliné dans ta vie privée que dans ton travail ?
F. Z. : Oui.
G. R. : Tu as dit un jour que
dans ton travail tu utilisais Dieu comme énergie...
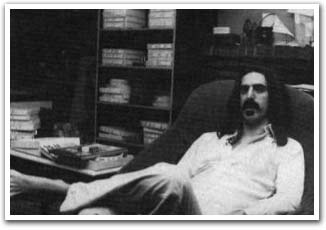 F. Z. : Hmmm. Je pense que tout le monde a une
idée de ce que Dieu pourrait être. Certaines personnes en
retirent le côté facile, c’est-à-dire la version
que l’église en donne ; on te dira que Dieu est comme ci et
comme ça, et comme tu es paresseux et que tu ne t’es jamais
penché sur le problème, tu mets un peu d’argent dans leur
boîte et tes dons t’offrent une tranquillité d’esprit; et
moi je suis ma propre voie.
G. R. : Qui est ?
F. Z. : Ça n’intéresse pas ton journal.
G. R. : Fais-tu de la
méditation ?
F. Z. : Est-ce que j’ai l’air d’un des BEATLES ?
Sa
femme nous apporte du café à la française;
s’ensuit une discussion de caractère culinaire…
G. R.: Tu as critiqué
beaucoup de choses telles que la drogue, les hippies, les gurus; en
quoi crois-tu ?
F. Z. : Je sais ce qui est beau je suis entièrement dévot
à mon idéal esthétique et je continue mon chemin
vers cet idéal à travers le bordel compliqué de la
société moderne. Par exemple, en ce moment, je travaille
sur un film qui nécessite des équipements techniques et
pour le faire j’ai besoin d’utiliser ces machines, les laboratoires
adéquats pour les tirer, et j’ai besoin d’accéder
à d’autres équipements qui sont tous très chers;
avant de pouvoir réaliser tout ça, j’ai besoin de gagner
de l’argent. Si tu es un poète tu n’as qu’à prendre un
crayon et un papier et c’est bon. C’est comme former un groupe et
l’emmener en tournée, les gens vont voir un spectacle en pensant
que tu grimpes sur scène et joues, ils se trompent, on a
répété trois mois avant notre US. tour.
G. R. : Tous tes rêves
sont chers ?
F. Z. : Malheureusement oui.
G. R. : Quel genre de film
prépares-tu?
F. Z. : C’est un film pour le cinéma et il s’appelle «
BABY SNAKES ».
Nous
buvons alors un verre de vin pour réalimenter nos gorges
atrocement desséchées, et nous repartons de plus
belle.
G. R. : Comment expliques-tu le
succès que tu as en Europe par rapport aux U.S.A.?
F. Z. : Le marché américain du disque est basé sur
des gens qui écrivent de la musique pour les directeur de
programme, c’est-à-dire les programmateurs de chansons sur les
différentes chaînes de radio; on leur donne une liste
chaque semaine de ce qu’ils sont supposés faire passer, et s’ils
le jouent suffisamment souvent, ces morceaux deviendront des tubes,
leur taux d’écoute augmentera, ainsi que leur tarif de
publicité.
G. R. : En France nous avons
très peu de station qui passent du rock, mais il y en a tant aux
U.S.A...
F. Z. : Et elles sont toutes en compétition ; le piège de
la musique populaire aux U.S.A. est que les groupes ne jouent plus la
musique qu’ils aiment, mais la musique que le directeur de programme va
aimer. Nous on ne doit pas plaire aux directeurs de programme... En
Europe c’est diffèrent, les gens viennent aux concerts,
achètent les disques; nous allons là-bas tous les ans
depuis 1967, et je ne pense pas qui y ait beaucoup d’autres groupe qui
le fassent.
G. R. : Que penses-tu du public
français ?
F. Z. : J’ai été surpris l’année dernière
quand j’ai joué aux abattoirs, de voir que leur
compréhension de l’anglais s’est améliorée, mais
je me sentais mal pour ces gens parce que c’est vraiment un endroit
horrible.
G. R. : Penses-tu pouvoir
exprimer la même chose aux non anglophones ?
F. Z.: Il y a une chose qui les touches tous c’est la musique, s’il
aiment le son ils n’ont pas besoins de comprendre les paroles.
G. R. : Mais ta musique est de
plus en plus vocale.
F. Z. : Oui. S’ils comprenaient les paroles ils en tireraient
certainement plus de choses, mais ce n’est pas un problème.
G. R. : Est-ce que tu fais un
show différent suivant l’endroit où tu te trouves ?
F. Z. : Il y a certains morceaux que nous ne jouons pas dans les pays
ou la compréhension de l’anglais est vraiment faible, ceux qui
comportent de longs passages parlés et
généralement en Europe ils ont une plus grande
tolérance pour la musique instrumentale
G. R. : Pourquoi ?
F. Z.: Parce qu’il y a une plus grande tradition musicale qu’aux U.S.A.
G. R. : Que penses-tu des
« TUBES » ?
F. Z. : On m’a dit qu’ils avaient un très bon show. Ils sont
connus là-bas ?
G. R. : Ils viennent de passer
à Paris et on a dit qu’ils étaient le version 78 de ce
que tu faisais Il y a dix ans.
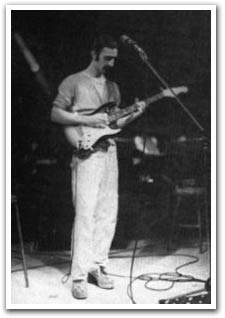 F. Z. : J’ai fait beaucoup de choses il y a dix ans qui
influenceront
des gens plus tard.
G. R. : Serais-tu prêt
à produire des groupes comme tu l’as fait auparavant ?
(GRAND FUNK, ALICE COOPER.)
F. Z. : Ça dépend du groupe, ça dépend si
j’ai le temps ; je n’ai rien de prévu.
G. R. : Que penses-tu des
journalistes ?
F. Z. : La réponse que je donne généralement aux
U.S.A. est : le journalisme rock est fait par des gens qui ne savent
pas écrire, parlant de gens qui ne pensent pas et
préparant des articles pour des gens qui ne savent pas lire. Le
seul endroit pire qu’ici est l’Angleterre.
G. R. : Vois-tu toujours des
gens comme CAPTAIN BEEFHEART ou CAL SCHENKEL?
F. Z. ; Je n’ai pas vu CAL depuis un an, mais BEEFHEART était
ici il y a trois semaine…
G. R. : Que penses-tu de sa
musique, a-t-il pris la même direction que toi ?
F. Z. : Non, différente,
G. R. : Tu penses qu’il est
toujours dans l’ « underground »?
F.Z. : Je ne sais pas ce que ça veut dire... Il ne choisit pas
de jouer pour une petite audience; il devrait y avoir plus de monde
pour l’écouter.
G. R. : Ton audience s’est elle
agrandie lorsque tu es retourné vers une musique plus
traditionnelle ?
F. Z. : Certains de mes premiers albums contiennent du rhythm’n’blues ;
non, je crois que l‘audience s’est agrandie grâce à plus
de concerts. « 200 MOTELS » est un film qui a aidé
à agrandir notre audience aussi.
G. R. : Je voulais dire la
transition « GRAND WAZOO » « OVER NITE SENSATION
».
F. Z. : Tu te souviens que j’avais fait « GRAND WAZOO »
dans une chaise roulante; j’ai eu cet accident en Angleterre et j’ai
été obligé d’arrêter la route pendant un an.
J’ai fait quatre albums pendant cette période: « JUST
ANOTHER BAND FROM L. A », « GRAND WAZOO » ,«
WAKA/JAWAKA », et « RUBEN & THE JETS FOR REAL »
qui est sorti chez MERCURY ; et puis on a eu le contrat pour DISCREET ;
j’ai créé un nouveau groupe avec RUTH UNDERWOOD, JEAN.LUC
PONTY, GEORGE DUKE... et il n’y avait pas de chanteur. J’ai
auditionné beaucoup de gens, mais comme personne ne faisait
l’affaire, j’ai dit OK je vais le faire moi-même : et c’est comme
ça que ça se passe depuis « OVER NITE SENSATION
».
G. R. : Tu fais de la musique,
des films, du business, quoi encore?
F. Z. : Non rien, je peignais avant, mais je n’ai pas peint depuis
vingt ans.
Il
me montra alors une partition qu’il vient de terminer, et qu’il veut
proposer à un orchestre européen lors de sa
tournée.
G. R. : Tu as une idée de
qui pourrait jouer ça?
F. Z. : Il faut un grand orchestre, environ 120 musiciens.
G. R.: Ça a l’air
compliqué. Il n’y a aucune partie vocale?
F. Z. : Non.
G. R. : Pourquoi le choix d’un
orchestre européen ?
F. Z. : Je pense que ça les intéressera plus que les
Américains. Les Américains veulent seulement jouer
BEETHOVEN, tu vois ce que je veux dire ? Pour que les vieilles avec
leurs cheveux bleus puissent avoir l’impression d’aimer la musique
(c’est la première fois qu’il rit franchement). Les orchestres
américains sont comme les stations de radio, ils jouent
seulement les tubes !
G. R. : C’est comme
l’Américain moyen type que essaie d’être à la mode.
F. Z. : Ouais ! Les A.M.T. trouvent leur mode dans des endroits ou on
l’a déjà décidée pour eux et sans aucun
goût.
G. R. Comme à WOOLWORTH ?
F. Z. : Non, Il y a des trucs super à WOOLWORTH ! (rires). Les
gens vont dans les magasins, prennent 2 comme ci, 3 comme ça, 4
comme ceux-ci, puis ils rentrent chez eux, mettent tout à la
fois quelles que soient les couleurs... Les pires sont ceux qui vont
à PARIS-FRANCE pour boire un verre de champagne et se balader
rive gauche avec leurs six appareils photo... C’est déjà
assez dur pour eux de dire « Oui-Oui », sans éclater
de rire !
Nous
buvons notre quatrième tasse de café et fumons notre
onzième cigarette (car nous sommes des gens très sains).
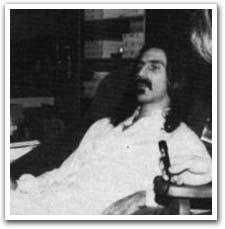 G. R. : Comment
présentes-tu les nouveaux morceaux à ton groupe ? G. R. : Comment
présentes-tu les nouveaux morceaux à ton groupe ?
F. Z. J’écris toutes les partitions, puis je synchronise le jeu
des musiciens. C’est comme un projet d’architecture ou je planifie ce
qui va se passer ; les musiciens lisent leur partie, et tout sort en
même temps.
G. R. : Tu utilises seulement
des musiciens qui savent lire la musique ?
F. Z. : Non, n’emporte qui pouvant mémoriser rapidement.
G. R. : Comme AYNSLEY DUNBAR !
F. Z. : Oui, AYNSLEY a une très bonne oreille; il essais 2 ou 3
fois, et c’est greffé pour la vie.
G. R. : Quels sont tes mauvais
souvenirs de musiciens avec lesquels tu as joué?
F. Z. : Au moment où je jouais avec eux je les aimais tous.
Certains sont partis pour diverses raisons, et ce serait tentant de
dire ; « Ceux-la étaient une bande de trous du culs
», mais je ne le ferai pas.
G. R. : Comme JEAN-LUC PONTY !
F. Z. : Je ne préciserai pas; mais crois-moi, il y en a eu.
G. R. : Certains t’ont
critiqué après avoir quitté le groupe...
F. Z. : Je pense quels ont dit des choses sur moi lors d’interviews
pour se faire de la publicité.
G. R. : Penses-tu être
naturellement doué pour la musique, ou l’as-tu beaucoup
travaillée ?
F. Z. : Je sais que je suis doué parce que je n’ai pas du tout
travaillé.
G. R. : Es-tu différent
des autres ?
F. Z. : Ouais.
G. R. : Tes influences musicales
aujourd’hui sont’elles les mêmes qu’en 64 ?
F. Z. : Les mêmes depuis « FREAKOUT »
G. R. : Pourquoi les exprimes-tu
différemment ?
F. Z. : J’essaie de prendre avantage des moyens mis à ma
disposition ; quand j’ai enregistré « FREAK OUT » je
n’avais qu’un magnéto 4 pistes ; avec un 24 pistes ça
aurait sonné différemment; et si les musiciens avec
lesquels j’ai enregistré « F.O. » avaient
été aussi bons que ceux avec lesquels je vais venir en
Europe...
G.R. : Il y aura beaucoup de
solos dans ton prochain show ?
F. Z. : Probablement, spécialement en Europe.
G. R. : Des improvisations ?
F. Z. : Il y en a toujours eu, mais dans un temps défini parce
qu’il faut savoir où le show va aller. Les gens veulent une
continuité dans le spectacle, ils veulent une forme.
G. R. : Le fait que tu changes
souvent de musiciens signifie-t-il qu’ils correspondent mieux à
ta nouvelle orientation?
F. Z. : C’est une des raisons ; l’autre est que j’engage parfois des
musiciens qui ne supportent pas les tournées.
G. R. : Ils partent
d’eux-mêmes ?
F. Z. : Oui. Il y en a qui partent puis qui reviennent.
G. R. : Utilises-tu toujours la
notion de Continuité Conceptuelle?
F. Z. : …
G. R. : Si je voulais
découvrir ma propre C.C., que suggérerais-tu?
F. Z. : Je ne sais pas si tu en as une ; tout le monde n’en a pas ;
certains ne réalisent même pas ce que ça veut dire.
Le concept y est exprimé dans la structure de mon nouveau film :
il faut que chaque section ait un rapport avec la suivante et les
éléments de connection sont parfois minuscules. Par
exemple tu vois cette voiture de police ? ( il me montre une mini voiture de police
pour enfants ; il appuie sur le phare clignotant  rouge et une
sirène se déclenche ainsi qu’une voix disant : «
Vous êtes cernés, rendez-vous.. » suivie de coups de
mitraillette. rouge et une
sirène se déclenche ainsi qu’une voix disant : «
Vous êtes cernés, rendez-vous.. » suivie de coups de
mitraillette.) C’est un morceau de continuité
conceptuelle. Comment imagines-tu que ça peut fonctionner en
tant que CC. ? (d’un air vainqueur). Tu peux pas hein ?
G. R. : Ça pourrait
être l’expression destinée aux enfants d’un besoin de C.C.
dans les renforts de police ?
F. Z. : C’est un des éléments. Je vais te dire quels sont
les éléments: Il y a ça, il y a la chanson «
YOU MUST HAVE BEEN A BEAUTIFUL BABY », il y a un masque à
gaz, et il y a un « poop shoot » ?
G. R. : Qu’est-ce qu’un «
poop shoot » ?
F. Z .: C’est un trou du cul ; dans ce cas-là ça
s’appelle un « poop shoot ».
G.R. : Ce sont les
éléments de C.C. de ce film ?
F. Z. : Certains des éléments. Il y a des moments
où tu peux les voir fonctionner tous ensemble mais ils ne
veulent rien dire eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire ?
G. R. : Eeuuhhh ?
Et
puis le "lunatisme" de Frank Zappa reprend le dessus ;
lui qui considère la roulette du dentiste comme un plaisir,
comparée à une interview, il m’invite à
déjeuner et à pénétrer dans sa vie
privée ; peut-être parce qu’il aime bien la France,
peut-être parce que je suis aussi musicien. Le micro de mon
recorder débranché, le masque tombe : et c’est avec la
gentillesse du père de famille qu’il me fait visiter sa maison :
une grande pièce ornée d’un gigantesque sapin de
Noël donne accès aux chambres et à la cuisine vers
laquelle nous nous dirigeons promptement appelés par les cris de
la faim. Il me présente sa femme, Gaël, qui mène un
combat sans merci avec le bouchon d’une bouteille de Muscadet ouverte
en mon honneur, et ses trois petits enfants qui ont l’air très
occupés à essayer de découvrir les mille
possibilités de leurs cadeaux de Noël. Nous
prenons chacun une assiette, allons nous installer dans son patio
étouffé de plantes tropicales et c’est à
l’américaine, sans cérémonie que nous
dégustons une cuisse de dinde en sauce. Frank Zappa est un
professeur, un maître et moi un élève qui m’apprend
comment reconnaître du premier coup d’oeil l’origine de quelqu’un
: les Français ont les cheveux oranges, les Hollandais ont de
mauvaises dents, les gens de Détroit ont d’horribles
chaussures... Images flashes du sociologue bouffon. Tex Avery de la
musique qui reste en dehors de toutes les modes, de toute implication;
et c’est pourquoi il est une légende. Il m’explique, qu’il a peu
d’amis, qui ne sort jamais, ne va même jamais au cinéma et
passe la majeure partie de son temps à travailler; son
énergie est sans limites, toujours renouvelée, toujours
présente; je lui demande quelle est sa technique (souffrant
moi-même d’une grande paresse), et il me répond avec un
sourire malin qu’il n’en a pas.
Il va répéter cet après-midi avec ses musiciens.
« Tu veux venir ? Oui ? Ok. Tu as une voiture ? En taxi ? Bon
alors attends moi, on ira ensemble » Pendant qu’il se
prépare, je jette un oeil sur ses 4 ou 5 000 disques parme
lesquels je peux remarquer toute la collection des BEATLES, du
free-jazz, beaucoup de RAVEL… Il réapparaît vêtu de
chaussures en python, d’un pantalon blanc trop grand, d’un blouson en
nylon noir, et d’un chapeau rond en feutre noir. Nous montons dans sa
Rolls-Royce noir, et descendons les collines noires… Non, pardon,
vertes de Laurel Canyon.
   L
L’endroit
est un
ancien studio de cinéma de trente mètres sur quarante,
loué pour l’occasion, dans lequel Roy Estrada, le vieux
Mother retourné au foyer, fait une démonstration de
frisbee à un roadie, Zappa prépare l’envol de son engin,
il tourne, cherche, règle, contrôle, s’accorde ; les
musiciens rejoignent enfin leurs instruments; Terry Bozzio
derrière ses fûts est calme et silencieux, tandis que les
autres plaisantent, s’agitent... Zappa est détendu, sûr de
lui, il est enfin vraiment lui-même. Il contrôle huit
musiciens par lesquels il va canaliser son humour, sa force, sa
technique ; et eux ils attendent. Il branche une Stratocaster et
commence « MONTANA »… Quelqu’un a dû
faire un imperceptible contretemps, il arrête tout d’un doigt et
recommence, 3 fois, 4 fois, mais ne s’énerve jamais ; les
musiciens, eux, commencent à s’énerver, alors ils jouent
« BABY SNAKES », nouveau morceau qui sera probablement la
musique de son film. Surprise toujours ; un morceau très long
où F.Z ne joue presque pas de guitare, mais chante
accompagné par un Roy Estrada en pleine forme, et dans la
structure interne du morceau: de longs passages dénudés
ou seule la voix de Zappa est présente ; puis départ de
le machine vers un éclatement rythmique contrôlé
c’est pas vraiment du rock, c’est un voyage fou à travers les
musiques d’ascenseurs, la télévision, les tares, le
spectacle de l’Amérique, puis Zappa enfourche sa nouvelle Gibson
marron sans jack (ce qui lui donne une complète autonomie dans
ses mouvements), et entame un solo wha-wha à phrases très
brèves et très rapides qui fait décoller le
morceau vers ses propres astres ; plus d’humour, plus de critique,
juste un son qui crève l’intellectualisme pour venir se loger
dans vos tripes et qui est bien trop beau pour être drôle.
Nouveau break ou Roy Estrada de sa voix très haute nous rappelle
les bons moments de « RUBEN & THE JETS » et puis,
surprise encore, avec un rythme presque disco à contretemps qui
dévie vers des dissonances. Les musiciens sont
très forts mais Zappa ne leur octroie pas une larme de
créativité ; ils sont ses instruments, sa
continuité ; il n’y a pas un son, pas une ambiance qu’il ne
contrôle pas : même pendant que les autres font une pause,
il règle inlassablement ses dix-huit pédales et son
ampli. Les jacks rebranchés, ils repartent avec « ZOOT
ALLURES » et cela dura jusqu’à onze heures du soir. Les
musiciens fatigués rangent leurs instruments et Zappa me demande
avec un air de connaître la réponse : « Tu crois que
les Français vont aimer ? » Les traits tirés et les
oreilles bourdonnantes chacun rentre chez soi se reposer car demain
ça recommence...
Le
lendemain je téléphone à Warner Bros pour savoir
ce
qu’ils pensent des accusations proférées contre eux : la
seule information que j’en tire est que je suis une personne
indésirable et qu’ils ne sont pas en mesure de
révéler quoi que ce soit pour l’instant. 
Je descends un peu en avance au bar de l’hôtel ou j’avais
rendez-vous avec une amie, j’y rencontre Pat O’Hearn, le tout jeune
bassiste qui vient d’Oregon; il est très timide, très
nerveux, mal à l’aise ; il me parle sans que je lui pose de
questions comme pour se défouler d’une trop grande oppression...
—« Moi je suis musicien de jeu, et je ne donne pas le meilleur de
moi-même avec Zappa; aucun de nous d’ailleurs sauf
peut-être Terry (Bozzio). Tu sais que Frank était batteur
au début, il est tyrannique mais très honnête: si
il vire quelqu’un au bout d’une semaine alors qu’il l’avait
engagé pour un an, il le payera quand même. »
— Ah ! Bon ? C’est lui qui prend l’initiative de les renvoyer ?
— Oui, il y a deux ans quand il a eu ses problèmes avec H. Cohen
et puis Warner, il a viré tout le monde et a formé un
nouveau groupe... »
Et c’est peut-être pour ça que au pied du sombre mur du
show-business Frank Zappa, soumis à un avenir incertain, donne
aujourd’hui le meilleur de lui-même…
Texte
& Interview : Gilles
RIBEROLLES.
Derniere
parution : Best
N°115 février 1978
|

