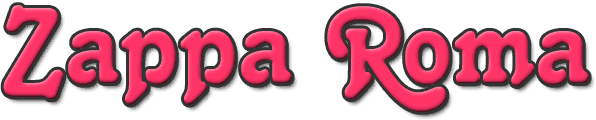
  ome.
Chaleur de fin d’été, lumière douce caressant les
murs
ocre rouge de la vieille ville. Calme d’une après-midi, dans le
bruissement des
fontaines — Trevi, Bernini. Et puis, tard dans la soirée, la
foule rieuse des
gens dans la rue, cherchant la fraîcheur de la nuit,
l’émotion des regards qui
se croisent, prunelles de velours sombre palpitant sous les longs cils,
romantisme
léger qui vous fait tout oublier. Ils sont beaux,
élégants et sans soucis, Une
ombre passe parfois, vibration éclatée d’un freak
paumé, les yeux trop fixes au
fond de leurs orbites creuses. Comment peut-on songer à se
déglinguer dans un
climat pareil ? Quelle maladie existentielle pousse à la
déchéance physique dans
un tel décor ? Quelle oppression se cache derrière les
éclats de rire et la
comédie de ce peuple fellinien ? Pour le Français, Rome
est un havre de paix,
de soleil ruisselant dans les coeurs, une communauté où
les regards ne se
fuient pas, mais jouent entre eux, où l’on ne craint pas de
parler à des
inconnu (e) s, où l’on sourit. ome.
Chaleur de fin d’été, lumière douce caressant les
murs
ocre rouge de la vieille ville. Calme d’une après-midi, dans le
bruissement des
fontaines — Trevi, Bernini. Et puis, tard dans la soirée, la
foule rieuse des
gens dans la rue, cherchant la fraîcheur de la nuit,
l’émotion des regards qui
se croisent, prunelles de velours sombre palpitant sous les longs cils,
romantisme
léger qui vous fait tout oublier. Ils sont beaux,
élégants et sans soucis, Une
ombre passe parfois, vibration éclatée d’un freak
paumé, les yeux trop fixes au
fond de leurs orbites creuses. Comment peut-on songer à se
déglinguer dans un
climat pareil ? Quelle maladie existentielle pousse à la
déchéance physique dans
un tel décor ? Quelle oppression se cache derrière les
éclats de rire et la
comédie de ce peuple fellinien ? Pour le Français, Rome
est un havre de paix,
de soleil ruisselant dans les coeurs, une communauté où
les regards ne se
fuient pas, mais jouent entre eux, où l’on ne craint pas de
parler à des
inconnu (e) s, où l’on sourit.
Loin des vieilles pierres et de l’animation populaire du
Transtevere et des places Farnese. Navonna, les lumières de la
Via Veneto
éclairent une scène bien différente. Des longues
terrasses de café où des visages
connus sirotent des capuccinos, des prostituées superbes
couvées par les
regards des chauffeurs de taxis, des maquereaux (« accatone
»), la faune du
spectacle.
Cinecitta à l’heure de la détente, après une
journée sous
les sunlights. On regarde, on est vu, la comédie ne
s’arrête jamais. Dans un
coin, autour d’une table, quatre personnages au visage fatigué
échangent des
plaisanteries en rigolant. L’un d’eux accroche immédiatement
l’attention avec
ses longs cheveux, sa moustache et sa barbiche familières: Frank
Zappa et ses
amis viennent de débarquer et se reposent
 endredi
6 septembre. Frank est debout de bonne heure et me
fait écouter les bandes de son show
télévisé, avant de partir pour la salle du
concert. Il est arrivé de Londres la veille, en provenance de
Los Angeles où il
mettait la dernière main à cette émission. Elle
dure une heure environ et sera
programmée dans tous les Etats-Unis. Une heure de musique
zappienne, avec les
nouvelles Mothers of Invention — neuvième formation depuis leur
création en
1964 à Cucamonga. Cette musique a été
spécialement écrite pour le show
télévisé, et semble s’inscrire dans la
continuité de l’oeuvre de Zappa, après
« Overnite
Sensation » et « AposTrophe(’) ». Proche du
rythm-and-blues, bourrée de
soul, en particulier grâce aux nouveaux musiciens venus de cette
scène,
Napoleon Murphy Brock et Ches1er Thompson. endredi
6 septembre. Frank est debout de bonne heure et me
fait écouter les bandes de son show
télévisé, avant de partir pour la salle du
concert. Il est arrivé de Londres la veille, en provenance de
Los Angeles où il
mettait la dernière main à cette émission. Elle
dure une heure environ et sera
programmée dans tous les Etats-Unis. Une heure de musique
zappienne, avec les
nouvelles Mothers of Invention — neuvième formation depuis leur
création en
1964 à Cucamonga. Cette musique a été
spécialement écrite pour le show
télévisé, et semble s’inscrire dans la
continuité de l’oeuvre de Zappa, après
« Overnite
Sensation » et « AposTrophe(’) ». Proche du
rythm-and-blues, bourrée de
soul, en particulier grâce aux nouveaux musiciens venus de cette
scène,
Napoleon Murphy Brock et Ches1er Thompson.
 a
matinée s’écoule tranquillement, les bandes
défilent
l’une après l’autre sur le magnéto stéréo
à cassettes que Frank trimballe
toujours en voyage. Il ne prend jamais le temps de visiter un peu les
endroits
pourtant extraordinaires qu’il traverse, Tout entier à sa
musique, il réécoute
sans arrêt ses concerts enregistrés ou ses sessions en
studio cherchant les
points à améliorer, les structures à faire
évoluer. Le résultat est connu : une
présentation impeccable, une musique qui tire toute sa force de
sa cohésion, de
cette espèce de logique progressive contenue dans ce que Zappa
appelle lui-mème
« la continuité conceptuelle». a
matinée s’écoule tranquillement, les bandes
défilent
l’une après l’autre sur le magnéto stéréo
à cassettes que Frank trimballe
toujours en voyage. Il ne prend jamais le temps de visiter un peu les
endroits
pourtant extraordinaires qu’il traverse, Tout entier à sa
musique, il réécoute
sans arrêt ses concerts enregistrés ou ses sessions en
studio cherchant les
points à améliorer, les structures à faire
évoluer. Le résultat est connu : une
présentation impeccable, une musique qui tire toute sa force de
sa cohésion, de
cette espèce de logique progressive contenue dans ce que Zappa
appelle lui-mème
« la continuité conceptuelle».
 ourtant,
depuis quelque temps, on l’accuse de facilité, on
lui reproche d’écrire une musique trop simple, trop commerciale.
Pour donner du
poids à leurs affirmations, les critiques se
référent surtout aux deux derniers
albums. ourtant,
depuis quelque temps, on l’accuse de facilité, on
lui reproche d’écrire une musique trop simple, trop commerciale.
Pour donner du
poids à leurs affirmations, les critiques se
référent surtout aux deux derniers
albums.
«
La raison pour laquelle je
joue cette musique
aujourd’hui, c’est parce que je l’aime, J’ai commencé en jouant
du r’n’b’ (cf
l’album « Ruben And The Jets», ancêtre des Sha-Na-Na
et autres ABDD).
Maintenant, j’aimerais jouer avec Howlin’Woff. »
- Chacun de tes
albums aujourd’hui semble
marqué par une
idée directrice, Dans «Overnite Sensation », par
exemple, on parle beaucoup de
sexualité.
- Cet
élément est
présent dans cet album, c’est vrai.
- Cela a un
rapport avec une certaine
tendance de libération
aux USA?
- Non, Il
s’agit de trucs personnels.
Comme dans l’album
« Fillmore East », ou il y avait effectivement des
histoires qui étaient
réellement arrivées à Mark (Volman) et Howard
(Kaylan). Le public aime bien
entendre des chansons qui parlent de sexe: cela le concerne aussi
après tout.
Ce qui m’arrive avec certaine filles peut être intéressant
pour un type à qui
le même genre d’aventures n’arrivera pas...
- Dans l’album
suivant, tu t’en prends
à la gouroumanie aux
USA (« Cosmik Debris « ).
- Hé,
hé... je joue ce
morceau depuis deux ou trois ans,
mais on l’a seulement mis cette année sur un disque
(« Apostrophe(‘) »).
- Il y a un
rapport avec le guru
Maharaj-Ji ?
- En fait,
c’est pour ça que je
l’ai écrit. Il est aux
States depuis deux ans. La première fois que je l’ai vu sur une
affiche j’ai
éclaté de rire.
- On peut
difficilement s’en
empêcher...
- Essaie de
penser à lui, pendant
sa performance; imagine
que durant la dernière partie de son numéro, il
enlève ses couches de bébé, les
arrose d’essence à briquet, et y met le feu, sur la
scène… (Sourire
méphistophélique du bon Frank ravi de ce nouveau
croche-pied à la « râclure
cosmique »)

 a
matinée s’achève. Quelques photos dont celles de ses
chaussures, peintes par Cal Schenkel le réalisateur de toutes
les pochettes des
Mothers. Déjà, il faut partir avaler un plat de spaghetti
froid (« un petit
fait que je replacerai dans une chanson »), répondre
aux interviews des
radios locales, puis se rendre au lieu du concert pour effectuer les
essais de
sono. C’est un palais des sports, tout rond, immense évoquant
les ruines
majestueuses du Colisée. Les spectacles de rock-and-roll sont
les jeux du
cirque de la génération coca-cola. L’ennui, c’est que ce
genre d’endroit n’a
pas du tout été construit pour recevoir un orchestre. Et
le bruit gigantesque
qui l’envahit soudain a bien du mal à être
maîtrisé par les ingénieurs du son.
L’un d’eux, Brian, a construit une nouvelle console, tout
spécialement pour
cette tournée. A peine branchée, elle explose.
Affolement, Il faut en trouver
une autre, plus résistante, dans le matériel de secours.
Les roadies
s’affairent, au milieu des amplis, des batteries, des vibraphones et
des
claviers. Une partie de l’installation a été louée
à ELP. a
matinée s’achève. Quelques photos dont celles de ses
chaussures, peintes par Cal Schenkel le réalisateur de toutes
les pochettes des
Mothers. Déjà, il faut partir avaler un plat de spaghetti
froid (« un petit
fait que je replacerai dans une chanson »), répondre
aux interviews des
radios locales, puis se rendre au lieu du concert pour effectuer les
essais de
sono. C’est un palais des sports, tout rond, immense évoquant
les ruines
majestueuses du Colisée. Les spectacles de rock-and-roll sont
les jeux du
cirque de la génération coca-cola. L’ennui, c’est que ce
genre d’endroit n’a
pas du tout été construit pour recevoir un orchestre. Et
le bruit gigantesque
qui l’envahit soudain a bien du mal à être
maîtrisé par les ingénieurs du son.
L’un d’eux, Brian, a construit une nouvelle console, tout
spécialement pour
cette tournée. A peine branchée, elle explose.
Affolement, Il faut en trouver
une autre, plus résistante, dans le matériel de secours.
Les roadies
s’affairent, au milieu des amplis, des batteries, des vibraphones et
des
claviers. Une partie de l’installation a été louée
à ELP.
 appa
monte sur scène quand les autres musiciens s’y
trouvent déjà, chacun réglant son instrument en
liaison avec l’équipe son,
perdue là-bas, très loin au fond de la salle. On
échange des plaisanteries. De
temps à autre, un regard se voile, un front se barre de rides
lorsque l’on
s’aperçoit que les échos jouent un peu trop au ping-pong
entre les murs. Mais,
quelle que soit leur faim ou leur fatigue. Zappa ne lâchera pas
ses hommes
avant d’être complètement certain que tout se passera bien
comme il l‘a prévu.
Cette exigence vis-à-vis de son art a parfois du mal à
être suivie par ceux qui
l’entourent. Et la discipline qu’il leur impose n’est pas toujours
bienvenue.
Les chocs d’egos sont fréquents et comptent pour une bonne part
dans les
innombrables changements de personnel du groupe. Frank s’assume
complètement
comme compositeur, auteur d’une oeuvre que d’autres interprètent
avec lui. Mais
ces autres ne sont souvent que des employés, salariés, et
leur orgueil de
musicien s’en ressent parfois durement. Ainsi, dans le dernier
numéro de « Rock
et Folk», Jean-Luc Ponty accuse Frank Zappa d’être un
« tyran », d’imposer
aux membres de son entourage un rythme de vie entièrement
dirigé par lui. appa
monte sur scène quand les autres musiciens s’y
trouvent déjà, chacun réglant son instrument en
liaison avec l’équipe son,
perdue là-bas, très loin au fond de la salle. On
échange des plaisanteries. De
temps à autre, un regard se voile, un front se barre de rides
lorsque l’on
s’aperçoit que les échos jouent un peu trop au ping-pong
entre les murs. Mais,
quelle que soit leur faim ou leur fatigue. Zappa ne lâchera pas
ses hommes
avant d’être complètement certain que tout se passera bien
comme il l‘a prévu.
Cette exigence vis-à-vis de son art a parfois du mal à
être suivie par ceux qui
l’entourent. Et la discipline qu’il leur impose n’est pas toujours
bienvenue.
Les chocs d’egos sont fréquents et comptent pour une bonne part
dans les
innombrables changements de personnel du groupe. Frank s’assume
complètement
comme compositeur, auteur d’une oeuvre que d’autres interprètent
avec lui. Mais
ces autres ne sont souvent que des employés, salariés, et
leur orgueil de
musicien s’en ressent parfois durement. Ainsi, dans le dernier
numéro de « Rock
et Folk», Jean-Luc Ponty accuse Frank Zappa d’être un
« tyran », d’imposer
aux membres de son entourage un rythme de vie entièrement
dirigé par lui.
« Je
répondrai ainsi
à Monsieur Ponty : il n’est pas un
homme honnête. De tous les musiciens avec lesquels j’ai
travaillé, je n’ai
jamais vu quelqu’un de plus intéressé par l’argent que
Jean-Luc. C’est la
raison pour laquelle il n’est plus dans l’orchestre. Il a essayé
de m’escroquer
(« play a trick») ainsi que Herb (Cohen, le manager),
et de ramasser ainsi
des sommes d’argent bien plus importantes que celles allouées au
reste du groupe.
J’ai pensé qu’il n’était pas très gentil, car on
l’avait aidé à venir aux USA,
payé pour cela un avocat, et donné beaucoup d’avantages
que personne dans le
milieu de la musique ne lui avait offerts avant.
Aucun
promoteur de jazz ni qui que ce
soit n’en a fait
autant pour Jean-Luc que notre société, et il nous a
remerciés en nous
escroquant. Et pas seulement ça : quand il l’a fait, il savait
que c’était une
bêtise. Quand je n’ai pas voulu marcher, il m’a dit: « Tu
me donnes plus
d’argent ou je m’en vais». Je lui ai répondu: «Au
revoir». Il était horrifié
parce qu’il n‘avait plus de boulot. Il parla à George (Duke) un
peu plus tard
et lui dit qu’il avait fait une erreur. Mais quand quelqu’un vient
l’interviewer,
que peut-il raconter ? Va-t-il admettre qu’il a fait cela? Non, il faut
qu’il m
‘appelle un « tyran ».
Avant lui,
d’autres avaient dit des
choses semblables:
Beefheart, Flo and Eddie, Roy Estrada, Art Tripp. Ils affirment tous
que Zappa
est terrible. Très peu de musiciens possèdent
l’espèce d’auto-discipline qui
est la mienne. Si tu veux avoir un groupe comme celui-là,
l’emmener autour du monde
et produire des bons concerts chaque fois que tu montes sur une
scène, tu n’y
arriveras pas en restant brouillon. II faut une discipline à
l’intérieur du
groupe. Certaines gens ne peuvent pas comprendre cela; d’autres le
peuvent. Certains
restent dans le groupe pour une raison bien simple: je leur donne
beaucoup
d’argent pour ça. Habituellement, si je m’aperçois qu’un
musicien reste
seulement parce que je le paie bien, il doit partir. Car je veux que
les gens
qui la jouent aiment la musique. Ils doivent la comprendre comme cela,
parce
que c’est le seul moyen pour qu’elle atteigne le public.
Il y a des
gens qui viennent dans le
groupe pour des tas
de raisons. Certains disent qu’ils aiment la musique, mais ce n’est pas
absolument vrai. Je vais les employer quand même, si j’ai besoin
de quelqu’un à
ce moment-là. Après, ils partiront. D’autres rejoignent
le groupe parce qu’ils
pensent: « Si je travaille avec Zappa pendant un moment, je vais
devenir
célèbre et j’irai faire quelque chose
d’autre »…
- On a un peu
ce sentiment en ce qui
concerne Flo and Eddie.
- C’est
exactement ça. A
l’époque où ils sont venus
travailler avec le groupe, ils étaient au chômage, leur
formation était dissoute;
ils n’avaient aucun moyen pour gagner leur vie et avoir leurs noms dans
les
journaux de musique. Dès qu’ils ont quitté les Mothers,
le seul moyen d’avoir leur
nom dans la presse a été de parler de moi. Ils n’avaient
rien à offrir par eux mêmes.
Ce qu’ils jouaient sur scène n’était pas d’eux: je
l’avais fabriqué à leur intention.
- Tous les
dialogues ?
- Non, pas
tous
les mots: j’avais construit une trame sur laquelle ils pouvaient
improviser.
Tout ce qu’ils jouaient était ainsi structuré: quelques
lyrics, puis un passage
où ils pouvaient improviser; ensuite, une partie centrale
comportant aussi une
improvisation; et puis une fin. C’était organisé, Pour
structurer cette
organisation, j’ai dû étudier et comprendre leurs
personnalités, afin de les
intégrer à la musique. Je ne pense pas qu’ils ont
apprécié le fait que J’ai agi
ainsi. La preuve de tout ça, c’est que tout ce qu’ils ont fait
depuis qu’ils
ont quitté les Mothers n’a pas eu beaucoup de succès,
artistique ou
autre. . »

 ne
heure et demie avant heure fixée pour le concert, les
réglages de sono paraissent enfin au point. Tout le monde se
précipite vers un
restaurant voisin afin de reprendre quelques forces. Longue attente
devant des
tables vides. L’impatience grandit. Zappa s’éloigne, revient
avaler une
assiette de spaghetti, chaude cette fois, Le vin est amère, et
l’on n’a pas le
temps de se plaindre. Tout est minuté, réglé
d’avance. Les impondérables,
fatigue, faim ou désir subit de vraie détente doivent
être oubliés. Seuls comptent
les moments de travail : réglages, répétitions,
concerts. Le rythme de la
tournée impose à tous une existence monacale, Et la
personnalité du maître,
secondé par son alter ego Herb Cohen, ne permet pas les
incartades, les
rebuffades ou les jérémiades. Quand on pense qu’il y a
des gens qui rêvent de
cette vie-là... ne
heure et demie avant heure fixée pour le concert, les
réglages de sono paraissent enfin au point. Tout le monde se
précipite vers un
restaurant voisin afin de reprendre quelques forces. Longue attente
devant des
tables vides. L’impatience grandit. Zappa s’éloigne, revient
avaler une
assiette de spaghetti, chaude cette fois, Le vin est amère, et
l’on n’a pas le
temps de se plaindre. Tout est minuté, réglé
d’avance. Les impondérables,
fatigue, faim ou désir subit de vraie détente doivent
être oubliés. Seuls comptent
les moments de travail : réglages, répétitions,
concerts. Le rythme de la
tournée impose à tous une existence monacale, Et la
personnalité du maître,
secondé par son alter ego Herb Cohen, ne permet pas les
incartades, les
rebuffades ou les jérémiades. Quand on pense qu’il y a
des gens qui rêvent de
cette vie-là...
 out
autour de l’immense rotonde, le public afflue,
cherchant les entrées, kids italiens ressemblant tellement
à leurs frères
anglais, français, américains... Jeans étroits,
T-shirts bizarres, longs cheve
flottants. Pourtant, dans son ensemble, cette foule est moins triste
que ses
semblables de nos régions. Beaucoup de sourires sur les visages
bronzés. Et les
filles sont belles, belles. 6 000 d’entre eux réussissent
à entrer ce soir-là. Les
places sont à 2 et 3000 lires, soit
15 et 20 francs. Vues les finances actuelles des Italiens, c’est
beaucoup, et
de nombreux jeunes devront rester à l’extérieur, tendant
l’oreille vers la
masse sonore qui perce les murailles de l’imposant édifice. Sur
scène, les
musiciens s’installent l’un après l’autre sous les hurlements de
l’assemblée.
Le tumulte est porté à son comble quand apparaît
Frank Zappa. Ils ont l’air
décontracté comme cela, mais leur tension interne est
immense: ils n’ont pas
joué ensemble depuis longtemps, et c’est le premier concert de
la tournée,
celui qui va déterminer, d’une certaine manière, l’humeur
des jours qui vont
suivre. Après une brève ouverture, ils commencent par
deux morceaux figurant
dans « Apostrophe (‘)»: « Stinkfoot », puis
« Cosmik Debris ». On retrouve
cette atmosphère, familière maintenant chez les Mothers
quels que soient les
membres qui composent le groupe: les paroles mâchées par
Zappa, entre coupées
de brefs soli de guitare incisifs, les gestes impératifs qui
dirigent l’orchestre,
l’attention que leur portent les autres musiciens, absolument
guidés par cette
main, cet index précis; les sourires qui détendent
parfois. Légèrement, le
climat, et puis la fièvre qui monte, alors que se resserre la
trame des parties
instrumentales; et les parties improvisées — en apparence au
moins — sortes de
récréation que Frank accorde à ses assistants,
avant de les ramener à leur
interprétation de son oeuvre. De tous, seul George Duke a l’air
de savoir se
tirer tout seul des péripéties imposées par chaque
morceau. Il n’a pas besoin
de garder les yeux rivés sur les gestes du guitariste pour
savoir ce qu’il a à
faire. Sa maturité, son métier de musicien devraient
même lui permettre de
figurer davantage comme auteur au sein des Mothers. out
autour de l’immense rotonde, le public afflue,
cherchant les entrées, kids italiens ressemblant tellement
à leurs frères
anglais, français, américains... Jeans étroits,
T-shirts bizarres, longs cheve
flottants. Pourtant, dans son ensemble, cette foule est moins triste
que ses
semblables de nos régions. Beaucoup de sourires sur les visages
bronzés. Et les
filles sont belles, belles. 6 000 d’entre eux réussissent
à entrer ce soir-là. Les
places sont à 2 et 3000 lires, soit
15 et 20 francs. Vues les finances actuelles des Italiens, c’est
beaucoup, et
de nombreux jeunes devront rester à l’extérieur, tendant
l’oreille vers la
masse sonore qui perce les murailles de l’imposant édifice. Sur
scène, les
musiciens s’installent l’un après l’autre sous les hurlements de
l’assemblée.
Le tumulte est porté à son comble quand apparaît
Frank Zappa. Ils ont l’air
décontracté comme cela, mais leur tension interne est
immense: ils n’ont pas
joué ensemble depuis longtemps, et c’est le premier concert de
la tournée,
celui qui va déterminer, d’une certaine manière, l’humeur
des jours qui vont
suivre. Après une brève ouverture, ils commencent par
deux morceaux figurant
dans « Apostrophe (‘)»: « Stinkfoot », puis
« Cosmik Debris ». On retrouve
cette atmosphère, familière maintenant chez les Mothers
quels que soient les
membres qui composent le groupe: les paroles mâchées par
Zappa, entre coupées
de brefs soli de guitare incisifs, les gestes impératifs qui
dirigent l’orchestre,
l’attention que leur portent les autres musiciens, absolument
guidés par cette
main, cet index précis; les sourires qui détendent
parfois. Légèrement, le
climat, et puis la fièvre qui monte, alors que se resserre la
trame des parties
instrumentales; et les parties improvisées — en apparence au
moins — sortes de
récréation que Frank accorde à ses assistants,
avant de les ramener à leur
interprétation de son oeuvre. De tous, seul George Duke a l’air
de savoir se
tirer tout seul des péripéties imposées par chaque
morceau. Il n’a pas besoin
de garder les yeux rivés sur les gestes du guitariste pour
savoir ce qu’il a à
faire. Sa maturité, son métier de musicien devraient
même lui permettre de
figurer davantage comme auteur au sein des Mothers.
 a
grande découverte de cette tournée est le chanteur,
flûtiste, saxophoniste Napoleon Murphy Brock. Du
rhythm-and-blues, il a gardé
un feeling et une présence physique sur scène
extraordinaires. Il fait
merveille dans les nouvelles compositions, et l’on songe à ce
qu’affirme Zappa
sur les raisons qui guident son choix des musiciens, Il ne pouvait pas
mieux
trouver pour interpréter ses morceaux les plus marqués
par l’influence du
r’n’b’. A part « Montana », venu aussi de Apostrophe (‘)
». Ils constituent
toute la deuxième partie du show, menée à un train
d’enfer, grâce à une
fantastique section rythmique (Chester Thompson aux drums, Tom Fowler
à la
basse et Ruth Underwood aux percussions)). C’est d’abord «
Chester’s Gorilla »,
orné d’un solo de guitare comme seul Frankie sait en sortir de
temps à autre
(cf. « Willie The Pimp »). Cascades de notes
méchantes, en succession très
rapide, dans un torrent de soul qui vous coupe le souffle et vous
emporte,
propulsé par le son énorme de l’entité
basse-batterie. A peine le temps de redescendre sur
terre pour un aimable « Montana », et la fête
reprend de plus belle avec «
Dupree’s Paradise », qui permet à Napoleon de faire un
numéro de danse
étonnant, et se termine par un dialogue très comique
(« Pygmy Twilight »)
entre Nap et Zap. Il y est vaguement question d’un client (Zap) qui
commande au valet d’un hôtel (Nap) toutes sortes de choses
impensables, et que je laisse à votre imagination le soin de
deviner. Tout au
long de cette séquence, Napoleon n’arrive pas à garder
son sérieux, pouffant de
rire â chaque fois que Zappa, toujours de marbre, lui fait part
de ses désirs.
Final bien dans la tradition Mothers, rires et joie musicale, explosion
du
corps et de l’esprit, dans un orgasme foutrement libérateur. a
grande découverte de cette tournée est le chanteur,
flûtiste, saxophoniste Napoleon Murphy Brock. Du
rhythm-and-blues, il a gardé
un feeling et une présence physique sur scène
extraordinaires. Il fait
merveille dans les nouvelles compositions, et l’on songe à ce
qu’affirme Zappa
sur les raisons qui guident son choix des musiciens, Il ne pouvait pas
mieux
trouver pour interpréter ses morceaux les plus marqués
par l’influence du
r’n’b’. A part « Montana », venu aussi de Apostrophe (‘)
». Ils constituent
toute la deuxième partie du show, menée à un train
d’enfer, grâce à une
fantastique section rythmique (Chester Thompson aux drums, Tom Fowler
à la
basse et Ruth Underwood aux percussions)). C’est d’abord «
Chester’s Gorilla »,
orné d’un solo de guitare comme seul Frankie sait en sortir de
temps à autre
(cf. « Willie The Pimp »). Cascades de notes
méchantes, en succession très
rapide, dans un torrent de soul qui vous coupe le souffle et vous
emporte,
propulsé par le son énorme de l’entité
basse-batterie. A peine le temps de redescendre sur
terre pour un aimable « Montana », et la fête
reprend de plus belle avec «
Dupree’s Paradise », qui permet à Napoleon de faire un
numéro de danse
étonnant, et se termine par un dialogue très comique
(« Pygmy Twilight »)
entre Nap et Zap. Il y est vaguement question d’un client (Zap) qui
commande au valet d’un hôtel (Nap) toutes sortes de choses
impensables, et que je laisse à votre imagination le soin de
deviner. Tout au
long de cette séquence, Napoleon n’arrive pas à garder
son sérieux, pouffant de
rire â chaque fois que Zappa, toujours de marbre, lui fait part
de ses désirs.
Final bien dans la tradition Mothers, rires et joie musicale, explosion
du
corps et de l’esprit, dans un orgasme foutrement libérateur.

 errière
la scène, alors que le plafond résonne encore des
milliers d’applaudissements, les musiciens commentent le spectacle. On
n’est
pas très satisfait au niveau du son, mais l’accueil du public a
été
remarquable. La sueur souligne les traits fatigués. Point de
groupies comme on
en voit dans les livres ou au cinéma. Les
musiciens en tournée doivent conserver quelque
chasteté s’ils
veulent tenir le coup. Le public, de toute façon, n’est pas
admis près des
loges, et dans peu de temps nos six gaillards seront en train de
roupiller dans
leur chambre d’hôtel. Le concert s’est terminé à
minuit. Le temps d’un dernier
capuccino sur la via Veneto, il est près de deux heures. Le
lendemain, le lever
est prévu à 6h 30; direction la prochaine étape.
Udine. errière
la scène, alors que le plafond résonne encore des
milliers d’applaudissements, les musiciens commentent le spectacle. On
n’est
pas très satisfait au niveau du son, mais l’accueil du public a
été
remarquable. La sueur souligne les traits fatigués. Point de
groupies comme on
en voit dans les livres ou au cinéma. Les
musiciens en tournée doivent conserver quelque
chasteté s’ils
veulent tenir le coup. Le public, de toute façon, n’est pas
admis près des
loges, et dans peu de temps nos six gaillards seront en train de
roupiller dans
leur chambre d’hôtel. Le concert s’est terminé à
minuit. Le temps d’un dernier
capuccino sur la via Veneto, il est près de deux heures. Le
lendemain, le lever
est prévu à 6h 30; direction la prochaine étape.
Udine.
- « On
dirait que tu suis deux voies
différentes. L’une avec
ton groupe, les Mothers of Invention, et l’autre avec des gens que tu
embauches
pour un seul disque. S’agit-il de concepts différents à
l’intérieur de ta «
continuité» ?
- Ce n’est
pas seulement ça :
à l’exception de
George Duke, qui peut jouer à peu prés de n’importe quel
instrument, la plupart
des musiciens sont spécialisés dans un genre particulier.
Si j’ai une idée pour
un morceau, qui requiert un certain style, je cherche des gens qui se
sentent à
l’aise dans ce style, afin que la musique soit bien jouée.
- Comment
peux-tu concilier cela avec ta
conception de la
«continuité» ?
- Prends un
paysage, et une route qui le
traverse:
l’ensemble est cette continuité.
- Pour beaucoup
de gens en France, les
Mothers et Frank
Zappa sont des produits typiques de l’environnement de Los Angeles...
- Pas
nécessairement. Il y a
peut-être une scène à LA,
mais je n’ai rien à voir avec elle: je suis trop occupé
à travailler. J’entends
par scène des endroits ou les gens vont traîner, en se
créant une attitude
sociale.
- Je pensais
à des gens particuliers,
ceux de Laurel Canyon
par exemple.
- Ils ne
sont plus là. Vito habite
dans le Nord de la
Californie. Il a quitté Laurel Canyon depuis cinq ans. Quant aux
GTO’s, une est
morte, deux sont mariées, une autre essaie de faire une
carrière d’actrice;
elles sont éparpillées.
- Elles te
doivent beaucoup ?
- Je ne
saïs pas si elles me doivent
quelque chose,..
- Mais tu les
as fait connaître...
- Je n’ai
jamais rien eu à voir
avec leurs personnalités.
- Toute une
mythologie de cette
époque circule aujourd’hui:
les GTO’s, Kim Fowley, Rodney Bingenheimer. Ces gens t’ont
concerné à un
moment, tu en as même produit quelques uns…
- Oui, je
les ai connus à ce
moment-là (1964-1968). J’ai
produit les GTO’s, Wild Man Fisher, Captain Beefheart. Mais jamais Kim
Fowley.
Il apparaît par-ci par-là, sur les albums des GTO’s, de
Wild Man Fisher, sur «
Freak Out »: c’est un de ces types qui traînent dans Los
Angeles et se pointent
aux sessions d’enregistrement des autres.
- As-tu
été le premier
à employer le mot « punk » (album «
We’re Only In It For The Money », 1967) ?
- «
Punk » est un vieux mot
d’argot américain. Il peut
signifier des tas de choses : quelqu’un de « vert»,
d’inexpérimenté, dans le
milieu des truands; un pied tendre; quelqu’un qui se fait enculer dans
une
prison...
- Tu as aussi
produit Alice Cooper.
- Oui. Mais
ce qu’il fait aujourd’hui ne
m’intéresse pas.
Je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit de musical derrière
son jeu de
scène. Tout ce qu’il fait venait d’une des filles des GTO’s, qui
lui a dit
comment s’habiller, C’était Miss Christine; elle est morte,
maintenant.
- Donc,
même les New-York Dolls
doivent quelque chose à Miss
Christine…
- Bien
sûr, c’est elle
(« She’s the one »)
-
Considères-tu les Dolls comme
représentant un certain état
de la jeunesse américaine d’aujourd’hui ?
- Qui que ce
soit qui sort un disque
reflète l’état de
l’Amérique d’aujourd’hui. Les Dolls n’ont pas une large
réputation au USA. Ils
ne sont pas très populaires.
- En France, il
y a des gens qui les
prennent comme modèles,
comme images...
- Oh,
vraiment ? (incrédule).
- Es-tu encore
concerné par les
aspects sociaux de
l’Amérique, comme le Zappa sociologue des années 66
à 69 ?
- J’aime
rapporter mes
expériences, regarder les choses
se passer et en retenir les aspects intéressants. Les chansons
que j’écris sont
plus ou moins généralisées dans un sens
sociologique. Comme elles l’étaient
naguère. Je traite des aspects spécifiques: «
Overnite Sensation », par
exemple, a beaucoup de côtes sociologiques, dans un sens
plutôt sexuel. Pareil
pour l’album « Fillmore East ».
- Certains mots
reviennent
périodiquement dans tes albums: l’histoire
du poncho...
- Laisse moi
te la raconter : aux USA,
tous les groupes
sociaux portent un costume particulier qui les distingue. Les filles
engagées
dans les marches pour la paix, les meetings, portent des ponchos. Cela
ressemble à une couverture de cheval, avec un trou au milieu
pour passer la
tête. Je demande, dans la chanson: « C’est un vrai poncho,
ou un poncho de chez
Sears ?» (Prisunic loca)
- Il y a
d’autres mots, «
zircon», «poodle (caniche) »...
- Si tu
prends n’importe quel mot et que
tu le répètes
suffisamment de fois là où on ne l’attend pas, tu fais
louer l’imagination.
C’est comme l’alchimie: un alchimiste prend de l’eau. Il a besoin d’une
certaine
sorte d’eau, le suc d’une certaine fleur: et cette eau
particulière fabrique un
sel particulier qui selon des circonstances données, permettra
un résultat
donné. Il se passe la même chose avec le «poodle
», le « tweezer » ou
le « zircon».
- Tu
considères donc ce que tu fais,
ta « continuité
conceptuelle » comme un processus alchimique.
- Oui. Avec
certaines étapes que
les gens reconnaissent
comme étant alchimiques et des éléments
particuliers à l’alchimie musicale, qui
seraient très peu utiles pour transmuter le métal.
- En Europe, on
associe souvent ce que tu
fais à la
pataphysique. On évoque a ton propos des gens comme Marcel
Duchamp, Alfred
Jarry...
- J’ai
déjà entendu le mot
« pataphysique » mais
c’est tout ce que j’en sais.
- D’où
provient ton inspiration, au
niveau des mots ?
- Je ne sais
pas. J’ai toujours
pensé que le tangage est
un phénomène singulier, surtout le langage parlé.
Je le considère d’un point de
vue musical, je pense que les mots peuvent être utilisés
de la même manière que
les instruments. Par exemple, la guitare: la façon normale d’en
jouer est de
gratter les cordes: mais on peut en tirer bien d’autres sons: le
feedback, ou
tirer les cordes, les frotter… C’est la même chose avec les mots.
Tu peux en
prendre un et le prononcer comme il faut. Mais tu peux aussi le dire
avec un
sourcil levé (il agite les sourcils de haut en bas,
très vite: effet plutôt
rigolo). Il prend une signification différente, même
si tu n’en
changes pas l’image.
- Les chanteurs
de r’n’b’ font cela aussi.
- Oui mais
avec des mots très
simples, pas avec des
choses inhabituelles.

 ome,
samedi 7 septembre. 7 h 30 du matin. Dans
le hall de
l’hôtel, on rassemble tout le monde
pour
un nouveau départ. Herb Cohen s’affaire alentour,
véritable petite fourmi qu’on
serait venu déranger dans son nid. Il prend soin de tout,
règle les histoires d’hôtel,
les manoeuvres des taxis vers l’aéroport, décide des
horaires de la journée,
repas, répétitions, prend les gens par la main, sans leur
laisser le temps de manifester
un quelconque désir d’initiative. Bientôt le groupe au
complet, 15 personnes en
comptant musiciens et roadies se retrouvent dans un jet, direction
Venise.
Pendant le voyage, Zappa sommeille, à l’écart. Chester et
Tom jouent aux
échecs. Martin (Perellis, le road manager du groupe) poursuit
inlassablement
son travail d’intendance. Nap et Ruth échangent des
plaisanteries. Il faut profiter
des voyages pour s’offrir un petit moment de détente.
  Venise,
pas question d’aller faire un
tour en gondole sous
le Rialto : on s’engouffre dans un autocar, direction Udine, lieu du
prochain concert. Tom et Chester reprennent leur
partie d’échecs, Zappa son roupillon et Ruth et Nap leurs
éclats de rire. Le
car fonce dans la campagne vers la prodigieuse barrière
formée par les
Dolomites. Mais on se soucie peu du paysage. Tous ces trajets sont
effectués
comme dans un rêve, images superposées de villes, de
montagnes, toujours
changeantes, presque illogiques pour ces gentils Américains
habitués à l’uniformité
sécurisante des intoroutes parsemées d’Holyday Inn et
d’Howard Johnson. Tout se
passe comme si on ne pouvait prendre le temps de s’émouvoir,
comme si
l’imagination tout entière devait rester à la disposition
d’un seul moment: le concert. Venise,
pas question d’aller faire un
tour en gondole sous
le Rialto : on s’engouffre dans un autocar, direction Udine, lieu du
prochain concert. Tom et Chester reprennent leur
partie d’échecs, Zappa son roupillon et Ruth et Nap leurs
éclats de rire. Le
car fonce dans la campagne vers la prodigieuse barrière
formée par les
Dolomites. Mais on se soucie peu du paysage. Tous ces trajets sont
effectués
comme dans un rêve, images superposées de villes, de
montagnes, toujours
changeantes, presque illogiques pour ces gentils Américains
habitués à l’uniformité
sécurisante des intoroutes parsemées d’Holyday Inn et
d’Howard Johnson. Tout se
passe comme si on ne pouvait prendre le temps de s’émouvoir,
comme si
l’imagination tout entière devait rester à la disposition
d’un seul moment: le concert.
 Udine, merveilleuse ville d’art de
la Renaissance, il a lieu, comme d’habitude, au Palais des
Sports. Une autre rotonde, plus petite que celle de Rome, et à
l’acoustique
nettement supérieure. Cela simplifie le travail des roadies, qui
doivent
installer le matériel pendant que le reste de la bande en
profite pour faire la
sieste. Pendant le déjeuner, Ruth ouvre son coeur. Oui, elle
aime bien cette
vie avec les Mothers. Mais pour elle, ce n’est pas une fin en soi. Elle
préférerait
diriger un orchestre, qui jouerait les
compositions de son mari Ian Underwood, saxophoniste chez les Mothers
of
Invention de 1967 à 1973. Elle voudrait bien, aussi, se
consacrer davantage à
la batterie, aux percussions, donner à un groupe son rythme, sa
pulsation.
Considère-t-elle sa présence dans une formation
internationale comme une victoire du Women’s Lib (le MLF
américain) ? Non, pas
spécialement. D’ailleurs, elle n’a pas d’idées
précises sur la question, et ne
se voit pas comme une musicienne de rock comme certaines
accompagnatrices de
Country Joe McDonald. Sur scène, elle se place à
l’opposé de Frank Zappa,
établissant un équilibre, comme si elle était sa
contrepartie féminine. Une
certaine ressemblance physique à l’exception des
pilosités faciales ajoute à
l’illusion. Udine, merveilleuse ville d’art de
la Renaissance, il a lieu, comme d’habitude, au Palais des
Sports. Une autre rotonde, plus petite que celle de Rome, et à
l’acoustique
nettement supérieure. Cela simplifie le travail des roadies, qui
doivent
installer le matériel pendant que le reste de la bande en
profite pour faire la
sieste. Pendant le déjeuner, Ruth ouvre son coeur. Oui, elle
aime bien cette
vie avec les Mothers. Mais pour elle, ce n’est pas une fin en soi. Elle
préférerait
diriger un orchestre, qui jouerait les
compositions de son mari Ian Underwood, saxophoniste chez les Mothers
of
Invention de 1967 à 1973. Elle voudrait bien, aussi, se
consacrer davantage à
la batterie, aux percussions, donner à un groupe son rythme, sa
pulsation.
Considère-t-elle sa présence dans une formation
internationale comme une victoire du Women’s Lib (le MLF
américain) ? Non, pas
spécialement. D’ailleurs, elle n’a pas d’idées
précises sur la question, et ne
se voit pas comme une musicienne de rock comme certaines
accompagnatrices de
Country Joe McDonald. Sur scène, elle se place à
l’opposé de Frank Zappa,
établissant un équilibre, comme si elle était sa
contrepartie féminine. Une
certaine ressemblance physique à l’exception des
pilosités faciales ajoute à
l’illusion.
 lus
tard dans la soirée, le concert sera magnifique. Zap et
Nap, plus en forme que jamais, font jubiler l’assistance. Frank sort un
de ses
soli de guitare les plus ravageurs qu’il m’ait été
donné d’entendre (dans «
Chesters Gorilla »). Tom exécute lui aussi un
numéro de basse extraordinaire,
digne de Jack Bruce, Et les trois, Napoleon, Tom et Frank, se lancent
dans une
parodie de hard rock irrésistible (quelque part dans «
Dupree’s Paradise »).
La foule hurle sa joie, et leur fait un triomphe qui efface les
souvenirs
d’ennuis de sono de la veille. En rappel, ils jouent un «
Camarillo Brillo »
très enlevé, mené par la guitare de Zappa,
plantant ses dernières flèches dans
un public surexcité. Enfin, deux heures plus tard, Frank quitte
la scène, laissant
ses musiciens tout seuls, qui jettent derrière eux des regards
inquiets,
attendant le signal du maître pour s’arrêter, il revient
et, caché du public,
en bas de l’estrade, mène d’un geste impérieux les
dernières mesures du
concert, Bizarre, ce détail comme si les Mothers
n’étaient pas capables de conclure tout seuls, que la
présence de Zappa soit toujours indispensable, qu’il les ait si
bien « dans le
creux de sa main » qu’il leur ait ôté tout
pouvoir sur sa musique. En un
éclair, c’est peut-être une faiblesse qui s’est
révélée. Mais le public n’en a
rien su. Et les rares initiés dans la coulisse font
peut-être eux-mêmes partie
de la structure zappienne, dépendants de lui et privés
d’initiative tant qu’ils
restent dans son entourage. lus
tard dans la soirée, le concert sera magnifique. Zap et
Nap, plus en forme que jamais, font jubiler l’assistance. Frank sort un
de ses
soli de guitare les plus ravageurs qu’il m’ait été
donné d’entendre (dans «
Chesters Gorilla »). Tom exécute lui aussi un
numéro de basse extraordinaire,
digne de Jack Bruce, Et les trois, Napoleon, Tom et Frank, se lancent
dans une
parodie de hard rock irrésistible (quelque part dans «
Dupree’s Paradise »).
La foule hurle sa joie, et leur fait un triomphe qui efface les
souvenirs
d’ennuis de sono de la veille. En rappel, ils jouent un «
Camarillo Brillo »
très enlevé, mené par la guitare de Zappa,
plantant ses dernières flèches dans
un public surexcité. Enfin, deux heures plus tard, Frank quitte
la scène, laissant
ses musiciens tout seuls, qui jettent derrière eux des regards
inquiets,
attendant le signal du maître pour s’arrêter, il revient
et, caché du public,
en bas de l’estrade, mène d’un geste impérieux les
dernières mesures du
concert, Bizarre, ce détail comme si les Mothers
n’étaient pas capables de conclure tout seuls, que la
présence de Zappa soit toujours indispensable, qu’il les ait si
bien « dans le
creux de sa main » qu’il leur ait ôté tout
pouvoir sur sa musique. En un
éclair, c’est peut-être une faiblesse qui s’est
révélée. Mais le public n’en a
rien su. Et les rares initiés dans la coulisse font
peut-être eux-mêmes partie
de la structure zappienne, dépendants de lui et privés
d’initiative tant qu’ils
restent dans son entourage.
- « Tu as
dit que tu aimais la Science
Fiction. Quel auteur
préfères-tu ?
- (Voix
fatiguée après le
concert.) Cordwainer Smith
(orthographe non garantie).
- Ta «.
Continuité conceptuelle
» me fait penser au thème de
« Fondation», d’Isaac
Asimov, Le « plan Seldon »…
- Il y a des
similarités…
- S’il fallait
tout recommencer, que tu sois
un teenager
maintenant, que feras tu ?
- Si
j’étais un teenager,
j’apprécierais le fait d’avoir
un groupe comme les Mothers of Invention. Quand j’étais à
l’école, il n’y avait
rien de ce genre-la. En un sens, c’est un service public (le groupe).
Mais si
j’étais un teenager et que j’écoute les Mothers
aujourd’hui je ferais
probablement quelque chose de différent. Les Mothers existant
déjà, je n’aurais
pas à les créer…
- Tu te sens
concerné par la culture
teenager ? Ta musique
est-elle dirigée vers leur monde?
- Non.
« Teenager», c’est
juste un terme pour désigner
les gens qui vont à un concert.
- Même
s’ils ont 45 ans ?
- C’est vrai.
- Comment
considères-tu ta jeunesse,
maintenant que tu as
presque 35 ans ?
- … 33 !
Mais je préfère de
beaucoup la vie que j’ai
aujourd’hui.
- Tu n’aimerais
pas être un teen de
nos jours...
- Non ! Pas
du tout ! A l’époque,
c’était plus frustrant.
Il fallait davantage se battre pour arriver à quelque chose,
aujourd’hui, il
existe des centaines de compagnies pour manufacturer des services,
fournir des
produits, juste pour les gens de ce groupe d’âge. Quand j’en
faisais partie, il
n’y avait rien de tout cela; pratiquement pas de concert, de musique...
- Tu te sentais
plus isolé…
- Je vivais
dans un endroit isolé.
- Tu te
référais à une
sorte de culture teenager ?
- Heu, oui,
Surtout celle des Mexicains
du coin, ils
parlaient anglais, mais ils avaient une culture spéciale.
- Tu jouais de
la musique avec eux ?
- De la
batterie. Je n’ai commencé
à jouer de la guitare
qu’à 18 ans, On jouait une espèce particulière de
r’n’b’. Aujourd’hui, on
appelle ces gens-là des « Chicanos » Mais
à l’époque, on les appelait des
« Pachucos ».
- Tu crois que
Santana est un
« Pachuco » ?
- Non. C’est
un « Chicano »
(rire). Les « Pachucos »
d’alors sont maintenant des « Veteranos », ils portent
toujours les mêmes
vêtements, les mémes coiffures…
- Cela a
dû te poser des
problèmes quand tu es devenu un «
freak ». C’est un peu comme en France...
- Je ne
crois pas qu’on puisse devenir un
« freak »
en France. Ou alors, cela doit être très dur.
D’après mon expérience de ce
pays, les choses ont l’air très fermées.
L’atmosphère, à Paris, m’a toujours
indiqué que tout était très réprimé.
- Il y a aussi
un manque de culture teenager
à laquelle se
référer. Il ne nous reste que celle de nos parents.
- Ça
doit être ennuyeux !
 dine,
8 septembre. 8 heures du matin. Le groupe
est déjà
levé, toiletté, rassasié et prêt â
embarquer dans son autocar, direction
Bologne où il doit jouer le soir même. On prend quelques
photos dans le soleil
éclatant qui inonde les vieilles pierres aux formes
harmonieuses. Dans le car,
les mêmes rites reprennent Chester et Tom avec leur
échiquier, le gros rire
plein de vie de Napoleon, Zappa allongé sur toute la banquette
arrière, Herb et
Martin réglant quelques détails de stratégie, et
George Duke poussant le grand
Nap à rigoler encore plus fort. Une cassette de rhythm-and-blues
passe sur
l’appareil stéréo du bord. Idéal pour les longs
parcours, cette pulsation, ce
soul. Bientôt le car s’arrête pour me déposer
à l’aéroport de Venise. Derniers
adieux, un immense sourire de Nappy, remerciements: à Herb Cohen
qui m’a
intégré à sa pettite famille, à Zappa,
à Dick Barber, son road manager
personnel qui a tout arrangé pour que vous puissiez lire ceci.
Et je les
regarde s’éloigner, tout petits sur la route. Il leur reste
encore vingt
concerts à donner en un peu moins d’un mois, à travers
l’Europe, de la Suède à
l’Espagne. Trois semaines à mener une existence qui rebuterait
un Spartiate,
soumis à une discipline très dure afin que survive leur
fragile microcosme et
pour que chaque soir explosent sous les voûtes des grands halls
bourrés de
teenagers cette prodigieuse musique, unie, tendue, cohérente,
forte, à l’image
de ce groupe et de son timonier. dine,
8 septembre. 8 heures du matin. Le groupe
est déjà
levé, toiletté, rassasié et prêt â
embarquer dans son autocar, direction
Bologne où il doit jouer le soir même. On prend quelques
photos dans le soleil
éclatant qui inonde les vieilles pierres aux formes
harmonieuses. Dans le car,
les mêmes rites reprennent Chester et Tom avec leur
échiquier, le gros rire
plein de vie de Napoleon, Zappa allongé sur toute la banquette
arrière, Herb et
Martin réglant quelques détails de stratégie, et
George Duke poussant le grand
Nap à rigoler encore plus fort. Une cassette de rhythm-and-blues
passe sur
l’appareil stéréo du bord. Idéal pour les longs
parcours, cette pulsation, ce
soul. Bientôt le car s’arrête pour me déposer
à l’aéroport de Venise. Derniers
adieux, un immense sourire de Nappy, remerciements: à Herb Cohen
qui m’a
intégré à sa pettite famille, à Zappa,
à Dick Barber, son road manager
personnel qui a tout arrangé pour que vous puissiez lire ceci.
Et je les
regarde s’éloigner, tout petits sur la route. Il leur reste
encore vingt
concerts à donner en un peu moins d’un mois, à travers
l’Europe, de la Suède à
l’Espagne. Trois semaines à mener une existence qui rebuterait
un Spartiate,
soumis à une discipline très dure afin que survive leur
fragile microcosme et
pour que chaque soir explosent sous les voûtes des grands halls
bourrés de
teenagers cette prodigieuse musique, unie, tendue, cohérente,
forte, à l’image
de ce groupe et de son timonier.
 lus
tard, après bien des aventures aéronautiques, je me
retrouvai dans le DC 8 Milan-Paris, assis à côté
d’un Japonais, violoniste au
sein du Los Angeles Philarmonic Orchestra. Nous avons passé le
voyage à
discuter de Zappa, de ses aventures avec Zubin Mehta et le LA Phila, de
la
bande sonore du film «200 Motels » et de
l’éventualité d’une réunion en
Europe des deux plus grands orchestres de Los Angeles. Après
tout cette
rencontre n’était peut-être pas un hasard. La main du
maître avait dû
l’intégrer quelque part dans sa « continuité
conceptuelle » lus
tard, après bien des aventures aéronautiques, je me
retrouvai dans le DC 8 Milan-Paris, assis à côté
d’un Japonais, violoniste au
sein du Los Angeles Philarmonic Orchestra. Nous avons passé le
voyage à
discuter de Zappa, de ses aventures avec Zubin Mehta et le LA Phila, de
la
bande sonore du film «200 Motels » et de
l’éventualité d’une réunion en
Europe des deux plus grands orchestres de Los Angeles. Après
tout cette
rencontre n’était peut-être pas un hasard. La main du
maître avait dû
l’intégrer quelque part dans sa « continuité
conceptuelle »
 ALAIN
DISTER. ALAIN
DISTER.
Rock &
Folk N° 94 octobre 1974
|

